

La Ville de Paris, telle qu’elle apparaît au visiteur aujourd’hui, a été créée par Napoléon III. Les quelques améliorations publiques faites depuis 1870 ne l’ont été que pour compléter le projet d’origine de l’Empereur et de son célèbre Préfet de la Seine. (Thomas W. Evans, The Second French Empire, 1905)
Nous commençons la deuxième partie de notre visite par le boulevard baptisé du nom de ce célèbre préfet, Georges-Eugène Haussmann, en particulier sur un lieu qui reflète non seulement les succès d’ordre matériel du Second Empire mais aussi ceux de la Colonie américaine
Métro #3: Havre-Caumartin
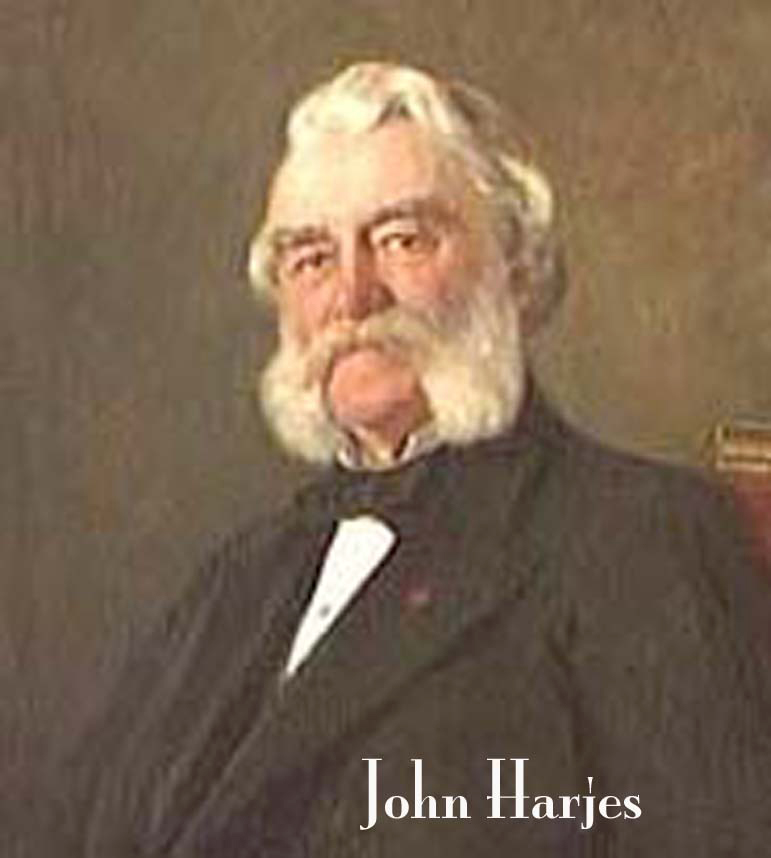
1: La banque Morgan-Harjes,
31 boulevard HaussmannUn « bureau de poste » pour les Américains en visite, comme allait le devenir plus tard l’American Express, la Banque Morgan-Harjes était beaucoup plus que cela, tenant un rôle clé dans la banque internationale. Son fondateur, John Harjes et son fils et successeur, Herman Henry, étaient tous deux des poids lourds de la Colonie Américaine. Ils ont fait tous les deux partie des créateurs de l’Hôpital Américain. Dès les débuts de la guerre, Herman Henry Harjes fut au cœur de nombre d’efforts américains de soutien à Paris : à la tête de la Croix Rouge Américaine, président de l’ARCH, fondateur du Corps d’Ambulance Morgan-Harjes.
La Morgan, véritable institution du monde de la banque internationale, était d’abord arrivée à Paris en 1868, ouvrant boutique au 3, rue Scribe sous le nom Drexel Harjes and Co, travaillant en étroite collaboration avec Drexel Morgan and Co de New-York. Aux Etats-Unis, c’était la grande période de la conquête de l’Ouest et de la construction des chemins de fer pour laquelle les gens de l’Ouest nous ont laissé des images de courses de chevaux sauvages et d’aventures extraordinaires. La Morgan recueillit le capital français et l’investit dans le rail américain. A cette époque, les chemins de fer américains enrichissaient leurs investisseurs. La fortune privée en France était tout-à-fait considérable à cette époque – elle l’est toujours – et la banque prospéra avec ses clients jusqu’au moment où la défaite de Sedan remit tout en cause ; Morgan transféra alors la moitié de son personnel en Suisse pour conserver le contact avec Londres et New-York. (Harjes Archives, n.d.)
* * * * * * *
Plus tard dans la journée, je repris mes esprits et descendis le Boulevard Haussman vers les bureaux de Morgan-Harjes. A propos de cet endroit, je me souviens avoir écrit à mon associé dans la banque que bien que leur mobilier ne soit pas aussi chic que le nôtre, ils semblent avoir plus de clients. Il n’y avait aucune nouvelle pour moi chez Morgan-Harjes. Je rentrai chez Henry pour le reste de l’après midi. Je me levai pour un dîner pris dans le café – et signai la note – une courte marche vers le Café de la Paix, de retour chez Henry et au lit, dormir, de retour à Verdun, de retour aux bombes hurlantes, au vrombissement des avions, aux rats et aux routes encombrées et sanglantes. (Philip Sidney Rice. An Ambulance Driver in France. 1918)
Thomas Wiltberger Evans
2: Le cabinet dentaire du Dr. Evans,
15 rue de la Paix
Or donc le 10 novembre 1847 les Evans embarquèrent pour l’Europe sur le vapeur Bavaria avec un trésor de cinq cents dollars. Evans ne connaissait rien de la France ou de Paris, n’avait aucune compréhension de la langue française. Mais il avait une confiance illimitée dans ses talents professionnels. Quatorze jours plus tard, les Evans arrivèrent au Havre, prirent le train vers Paris et se firent conduire à l’Hôtel de Normandie, rue de la Paix, rue éclairée au gaz, des commerces de luxe, des tailleurs à la mode, des joailliers et des dentistes. Le bureau du Docteur Brewster était pratiquement en face de l’hôtel, au numéro 11. En rencontrant les Evans le lendemain, le Docteur Brewster demanda à voir la caisse des plombages qui avait gagné la récompense de l’Institut Franklin, le regarda soigner un patient et se mit d’accord avec lui. Le Docteur Evans s’établit dans un appartement modeste au 39, rue de l’Arcade, derrière la Madeleine « car ses ressources » comme l’écrivit plus tard son neveu Théodore « étaient des plus modestes ». Cependant le jeune dentiste travailla son français, s’activa autour du fauteuil de dentiste et avait remonté ses économies dès juin 1848. L’association baptisée Brewster et Evans ne dura que jusque vers 1850. Après plusieurs dissensions personnelles et professionnelles avec Brewster, le Docteur Evans transféra son domicile et son cabinet dans un appartement au premier étage du 15, rue de la Paix (le deuxième étage selon l’usage américain) et se libéra ainsi du contrat quelque peu draconien que lui avait imposé le Docteur Brewster » (Gerald Carson. The Dentist and the Empress, 1983.)
* * * * * * *
Ma rencontre avec le Prince commença très vite après son arrivée à Paris. Il n’avait pas résidé longtemps à l’Elysée qu’il avait déjà fait demander au Docteur Brewster de venir au palais, s’il cela lui convenait, car il avait besoin de ses services. Il arriva que lorsque le message fut livré, le Docteur Brewster était malade et dans l'impossibilité de répondre lui-même à la demande. Il m’incomba donc, par chance, de prendre sa place à titre professionnel et de rendre visite au Prince. Et c’est ainsi que je le rencontrai pour la première fois à l’Elysée.
Il me reçut très gentiment, sans montrer qu’il s’attendait à voir quelqu’un d’autre, ce qui me fit être tout à mon aise. Je me rendis compte qu’une petite opération s’imposait, ce qui, une fois qu’elle fut pratiquée, lui soulagea grandement. Au moment de partir, le Prince me remercia avec profusion, me félicita pour la douceur de ma façon d’opérer en exprimant le désir de me revoir le jour suivant. Je le retrouvai alors, à titre professionnel, et de temps en temps, jusqu’au jour de sa mort, je lui rendais visite souvent, - parfois aussi souvent que deux fois par semaine, car les relations entre nous n’étaient pas entièrement professionnelles, mais devenant très rapidement amicales et même confidentielles. (Thomas W. Evans. The Second French Empire, 1905)

3: La banque Morgan-Harjes,
14 place Vendôme
La société se transféra du boulevard Haussmann au 14, Place Vendôme en 1919. Les nouveaux locaux donnaient plus d’espace au personnel de telle sorte que la société pouvait augmenter ses activités bancaires commerciales en organisant un Département de Crédit et des Statistiques, un Département des Changes et un département se consacrant aux lettres commerciales de crédit. La société continua cependant à se consacrer à la souscription et à la négociation des emprunts en francs français car le Trésor français n’autorisait pas l’émission de titres de sociétés étrangères. (Harjes Archives, n.d)
4: Le siège de la Cour Impériale des Tuileries et du Louvre
La véritable ruée de jeunes hommes et femmes venus étudier l'art en France et particulièrement à Paris, ruée initiée sous le Second Empire et qui se tarira tout à fait avec la Seconde Guerre Mondiale, est un phénomène sans équivalent dans les autres disciplines. Cette attirance pour la France s'explique par la conjonction de nombreux facteurs : la richesse croissante des Etats-Unis et son désir d'entrer dans l'arène culturelle internationale, la promotion des arts en France sous Napoléon III, et enfin les incitations prodiguées aux plus jeunes par ceux qui en sont revenus (Véronique Wiesinger, "Quelques idées générales", Le voyage de Paris, les Américains dans les écoles d'art 1868-1918 ; Editions de la Réunion des musées nationaux, Paris 1990)
* * * * * * *
Le dernier dîner officiel donné aux Tuileries le 7 juin 1870 était en l’honneur de E. B Washburne, Ambassadeur des Etats-Unis et Napoléon III raconta à cette occasion que son grand père, le Vicomte de Beauharnais, avait combattu pour l’Indépendance américaine » (François Boucher, American Footprints in Paris, 1921)
* * * * * * *
Le matin du 4 septembre (…) l’Impératrice Eugénie se leva tôt pour remplir les devoirs urgents qui lui incombaient maintenant en tant que Régente de l’Empire (…) l’Empereur prisonnier en Allemagne, la fleur de l’armée arraché de façon ignominieuse, les Prussiens arrivant rapidement vers Paris, des milliers désertant la ville, les troupes à disposition plutôt non entrainées et indisciplinées, Montmartre et La Villette soulevées entourée de conseillers tièdes et indécis, la situation de la Régente était périlleuse au plus haut degré (…)
La question fut finalement posée, car il devenait nécessaire que la Régente s’en aille pour sa propre sauvegarde, de savoir si quelqu’un avait prévu un carosse ou tout autre mode de fuite. Non : personne n’y avait pensé et il était maintenant trop tard. Ce fut à ce moment, cependant que l’Impératrice fit preuve de rapidité et d’agilité dans l’action : faisant venir à elle les différents officiers de la maisonnée, elle leur donna ses derniers ordres puis se tourna vers le Général Mellinet :
« Mon Général », dit-elle, « pouvez-vous défendre le château sans faire usage des armes ? »
« Madame », répondit le vieux défenseur des Tuileries, « je ne le pense pas »
« Alors », s’exclama l’Impératrice, « tout est perdu. Nous ne devons pas ajouter une guerre civile à nos désastres. » (Louis Judson Swinburne. Paris Sketches, 1875)
L’Impératrice se réfugia à Belle Rosa, d’où le Dr. Evans la fit s’évader en Angleterre. Presque un conte de fées, que le Dr. Evans ne se lassait jamais de raconter.
Nous traversons maintenant le grand fleuve, la Seine, passant de la Rive Droite à la Rive Gauche, des soutiens prospères de Paris et de sa Colonie Américaine, au monde enivrant de la jeunesse, des arts, des études, de « la Bohème. »
5: Gare d’Orsay,
62 rue de Lille
La gare :
C’est ici que les trains de Bordeaux débarquaient les bénévoles nouveaux arrivants qui étaient ensuite pris par des ambulances ou qui prenaient des taxis vers le siège d’AFS.
Nous sommes passés par Angoulême, Tours, Orléans et finalement arrivés vers neuf heures trente le matin au quai d’Orsay à Paris. Paris, cité de joie !!! Aussi surprenant que cela puisse paraître, je n’était pas excité le moins du monde d’y être ; j’avais l’impression que je venais d’en partir et le voyage en voiture vers la Rue Raynouard avait le caractère familier de quelque chose vue la veille (« Somewhere in France. » Personal Letters of Reginald Nöel Sullivan. 1917)
* * * * * * *
Ce printemps-là, tout le monde travaillait plus dur que jamais, mais Galatti en faisait à lui seul autant que nous tous réunis. Il ne prit jamais un jour de repos. Sept jours sur sept, il arrivait à bureau à huit heures au plus tard. Il quittait le bureau parfois à dix neuf heures, parfois plus tard. Et quelles journées de travail ! Il téléphonait à l’agent de Bordeaux, choisissait la personne qu’il fallait pour un poste vacant, envoyait des câbles pour rassurer les parents, inquiets sans nouvelles de leur fils, retrouvait des livrets égarés, dictait des lettres, commandait des plaques en bronze portant les noms des donateurs et veillait à ce qu’elles soient installées sur la bonne ambulance. Il prêtait son oreille à la grogne, organisait de nouvelles sections et si, à dix-sept heures, comme ce fut souvent le cas, on recevait un télégramme annonçant l’arrivée imminente de cinquante hommes sur le train de Bordeaux de 19 h 30, qu’importe, cela faisait partie du boulot. Il en faisait encore un peu plus que d’habitude et, à 19 h 30 il avait rassemblé assez de voitures à la gare d’Orsay pour transporter hommes et bagages. Un repas et des lits les attendaient. Et si le lendemain matin à six heures un convoi devait se rassembler, il était sur les lieux pour le voir partir. (J.R. Fisher, in AFS Bulletin of April 1919).
Le musée:
Le Musée d’Orsay fut inauguré le 9 décembre 1986 pour présenter les œuvres d’art de 1848 à 1914. Ses collections proviennent de trois endroits : le Louvre, le Jeu de Paume et le Musée National d’Art Moderne.
Introduction parfaite au Paris de la Rive Gauche, le musée met les visiteurs au contact avec les œuvres d’art qui ont attiré tellement de jeunes étudiants américains à Paris.
6: Ecole des Beaux-Arts,
14 rue BonaparteSi les Salons existaient bien avant Napoléon III, en revanche le Second Empire donne une nouvelle image de la France, luxueuse et moderne, patrie des arts et terre où la manne des commandes artistiques et achats de l'Etat semble se répandre comme nulle part ailleurs. Le prestige de l'Ecole des Beaux-Arts - surtout après la réforme de 1863 - surpasse peu à peu celui des Académies de Londres, Munich et Düsseldorf et attire les jeunes aspirants artistes d'Outre-Atlantique. Enfin, l'atmosphère créative de Paris d'Haussmann puis de la Troisième République qui se couvre de bâtiments nouveaux, de sculptures nouvelles ; le respect pour les métiers d'art ; l'attention portée par le public et les média aux expositions ; l'esprit d'émulation qui règne dans les écoles - tout ceci enthousiasme des jeunes gens venus d'un pays où l'on n'accorde que mépris à l'art contemporain indigène. (Véronique Wiesinger, "Quelques idées générales", Le voyage de Paris, les Américains dans les écoles d'art 1868-1918 ; Editions de la Réunion des musées nationaux, Paris 1990)
7: Académie Julian,
31 rue du DragonDestination favorite des étudiants américains en peinture et en sculpture, fondée en 1868 par le peintre français Rodolphe Julian (1839-1907)
Les artistes étaient une fois de plus un groupe intéressant vivant et étudiant à l’étranger. « Mon Dieu », s’exclama William M Chase, quand l’opportunité lui en fut donnée, « je préfèrerais aller en Europe que d’aller au Ciel ». Certains d’entre eux rejoignaient toujours les anciennes colonies à Rome et à Florence, quelques uns allaient à Londres, Munich (où Chase lui-même étudia) ou à la Haye. Ces années à la fin du dix-neuvième siècle, cependant, étaient l’époque où Paris arrivait en premier comme la ville des villes pour les peintres. Ils se réunissaient ici comme ils ne l’avaient jamais fait pour travailler sous les Maîtres français et profitaient de l’atmosphère romantique et libre de la Rive Gauche. Ils étudiaient dans des écoles d’art populaires comme l’Académie Julian, tellement bondée que les jeunes novices pouvaient à peine se mouvoir ; ils vivaient dans de petits greniers glacés qui servaient de studio, de chambre à coucher et de cuisine ; ils portaient les cravates bouffantes et les chapeaux à galon qui étaient les costumes convenus des artistes et se réunissaient la nuit dans les restaurants, brasseries et cafés du Quartier Latin. C’était le Paris de la légende bohème » (Foster Rhea Dulles. American Abroad. Two Centuries of European Travel, 1964.)
* * * * * * *
Au 25 mars 1891, son vingt-quatrième anniversaire, Gutzon avait fait six mois d’études à l’Académie Julian et avait été pris comme étudiant à l’école des Beaux Arts. Alors que Gutzon avait appris les techniques de base de la sculpture à l’Académie, c’est dans le studio de Rodin qu’il apprit les leçons fondamentales de l’honnêteté dans l’art. « En faisant un buste » conseillait Rodin, « vous devez créer ce que vous voyez, non pas ce que votre modèle souhaite que vous voyiez ». Il réaffirmait ce que Gutzon avait toujours cru, que pour être un grand artiste, il fallait avoir le respect de la beauté de la nature.
La première statue de Gutzon qui devait être dévoilée à la suite de l’Armistice était une qu’il avait pris un plaisir particulier à faire . C’était un mémorial à un pilote, James Rogers McConnell, un jeune étudiant de l’Université de Virginie tué tôt dans la guerre en volant pour la France. Quelques années auparavant, Gutzon avait travaillé sur la forme d’un être humain avec des ailes comme un mémorial pour les frères Wright. Cette forme ne fut jamais terminée ce qui fait qu’il mit quelques une de ses idées dans la statue de McConnell. Le mémorial terminé représente un jeune homme aux vastes ailes attachées à ses bras. Il se tient sur la pointe des pieds sur un globe comme il allait juste s’envoler. Le père du jeune McConnell qui assista à l’inauguration à l’Université de Virginie, écrivit à Borglum au sujet de la statue « Elle est magnifiquement belle, complètement expressive et hautement significative. » (Willadene Price. Gutzon Borglum, Artist and Patriot, 1961)
8: Musée du Luxembourg,
rue GuynemerInstitué en 1818 sous Louis XVIII pour l’exposition des travaux d’artistes vivants, le Luxembourg n’en n’a pas moins refusé la peinture d’avant-garde jusqu’à la fin du siècle. Une même réticence se trouvait à l’égard des peintres étrangers, bien qu’un grand nombre de leurs œuvres soit acheté par l’Etat – et donc stockés dans les réserves du Louvre, ce qui inspira son Conservateur du Département des Peintures, Pierre Rosenberg, à transformer le Musée de Blérancourt en un lieu où pouvaient être présentés les œuvres de peintres américains en France et de peintres français en Amérique.
9: La Sorbonne
Place de la Sorbonne
Le Quartier Latin est plein d’institutions prestigieuses d’enseignement supérieur, la plupart beaucoup moins bien connues des Américains que la fameuse Sorbonne.
Pour conclure, laissez-moi dire un mot sur cette partie de l’Université de Paris appelée la Sorbonne. La Sorbonne est la maison de nos Facultés des Lettres et des Sciences. Ici, avec la bibliothèque, elles occupent l’un des sites d’origine de l’Université de Paris. Cette institution – avec les Universités de Bologne et d’Oxford, les plus anciennes d’Europe – remonte au douzième siècle et en suivant le modèle classique, dont elle servit plus ou moins de modèle, elle fut d’abord composé d’un certain nombre de collèges séparés. Le nom Sorbonne fut donné à l’un de ces collèges fondés au treizième siècle sous Saint Louis par Robert de Sorbon, pour héberger les pauvres étudiants en théologie. Ce collège devint après la Faculté de Théologie. Au dix-septième siècle, la Sorbonne fut reconstruite par le Cardinal de Richelieu, le grand ministre de Louis XIII . Elle a été récemment reconstruite et agrandie (1885-1900) mais la chapelle de Richelieu où l’on peut encore voir la tombe du grand homme d’état et l’aspect général de la cour ont été préservés. L’emplacement de la Sorbonne évoque donc des souvenirs anciens et illustres. (Maurice Calléry, "French Universities and American Students", 1917.)
A la fin du dix-neuvième siècle, les Américains étaient attirés à Paris pour étudier d’autres sujets que l’art et l’architecture, mais ils faisaient face à d’autres obstacles.
Un Comité franco-américain avait été organisé à Paris sous la direction du ministère de l'Instruction publique, en vue de créer des grades universitaires pour les étudiants américains à Paris. A une réunion chez le Dr. T.W. Evans, le 8 juillet 1895, il fut décidé de former un comité local d'Américains pour favoriser ce mouvement. Ce comité fut nommé « The Paris-American University Committee », à une réunion qui eut lieu chez le Dr. Evans le mercredi 19 juillet 1895. Evans fut nommé président de ce comité, créé pour coopérer avec le Comité franco-américain, pour aider à l'extension des privilèges universitaires français aux étudiants américains, et pour favoriser leurs intérêts dans leurs relations avec les universités de France. (Correspondance de Stéphane Mallarmé, 1959).
Voici donc les racines des échanges AFS:
Il n’est pas déplacé de rappeler ici les origines de la Société pour les Bourses Américaines dans les Universités Françaises. Vers la fin de 1915, le Docteur John H Wigmore, Doyen de la faculté de Droit de l’Université Northeastern de Chicago, célèbre éducateur, fut à l’origine de la fondation de la Société qui à compter de maintenant va porter le nom des Bourses de l’American Field Service pour les Universités Françaises. Dans des correspondances avec le Professeur C H Grandgent, alors professeur associé à la Sorbonne, il apprit que le projet serait considéré avec bienveillance par les autorités françaises. L’Ambassadeur de France à Washington, M Jusserand, fit connaître également son profond intérêt à ce mouvement au Docteur Wigmore. (AFS Association Bulletin #2, July 1920)
* * * * * * *
Cette nouvelle vague d’ « aventuriers amis » d’Amérique (pour citer la phrase de Joseph Cochran) – étudiants en art, étudiants universitaires – faisait souvent face à des conditions difficiles loin de leur famille et des amis de leur terre natale. Leurs compatriotes américains bien établis s’en rendirent compte et vinrent à combler la brèche, préoccupés qu’ils étaient par le bien-être moral et physique de ces jeunes gens.
Le Quartier Latin avait été la Mecque des étudiants américains en art depuis le venue du peintre Vanderlyn, le premier américain à exposer au Salon Français de 1808, recevant la médaille d’honneur de Napoléon. Depuis lors, nombre de gens célèbres avaient reçu leur inspiration sous les ombres grisâtres du Luxembourg – Healy, Trumbull, Rembrandt Pearle dans les premières années, puis William Morris Hunt, John W Alexander, John Sargent, Whistler, George de Forest Brush and nombre d’autres peintres célèbres. Parmi les sculpteurs, Augustus Saint-Gaudens et Lorado Taft firent mûrir leur talent dans les studios de Paris.
Whistler avait l’habitude de dire : « Il y a quelque chose à Paris qui vous incite à faire de belles choses ». Les rarissimes voix du concert et de l’opéra, les plus grands maîtres des instruments de musique ont acquis technique et trouvé leur âme dans cette ville des belles choses. Le Directeur général de l’Exposition de Paris de 1900 disait que l’ambition des artistes américains est d’interpréter le monde d’aujourd’hui et qu’ils viennent à Paris pour en avoir l’expression.
C’est la raison pour laquelle des milliers de jeunes Américains ambitieux s’entassaient dans le Quartier Latin tous les ans. La plupart d’entre eux viennent avec des ressources limitées et sont contraints de chercher des logements surpeuplés et inconfortables. Ils vivent dans un environnement qui n’est pas tout-à-fait bon pour le bien-être physique et moral.
Ce ne fut que vers la dernière décennie du dix-neuvième siècle qu’une attention particulière fut donnée à ces conditions par ceux qui avaient les moyens financiers d’aider à améliorer les conditions de vie. (Joseph Cochran. Friendly Adventurers, 1931)
* * * * * * *
Il y a tellement d’Américains, jeunes gens et jeunes femmes, qui viennent à Paris pour étudier l’art et ne sont pas vraiment sérieux pour leur travail. C’est pour cette raison que vous n’entendez jamais plus parler d’eux. Paris est l’endroit le plus dur au Monde pour réussir. La concurrence est acharnée, les tentations nombreuses et difficiles à résister. Il faut de la grandeur d’âme pour éviter de tomber dans le maelstrom. Cependant, si vous « arrivez » à Paris, vous êtes absolument certain de réussir ailleurs.
Beaucoup de jeunes gens viennent ici en pensant réussir sur le champ et sans effort. La jeune fille américaine est frappée de stupeur par la vie du quartier. L’idée d’être assise dans des cafés et de fumer et de boire des liqueurs semble être son idéal. La femme a tout pour devenir « bohémienne » et après c’est adieu à tout autre travail sérieux pour elle. (Sara Morris Greene, « Hunting Bohemia Spoils Art Work, » New York Times, 29 Nov 1912)
* * * * * * *
Les Clubs des Etudiants Américains. Il y a à Paris nombre de clubs organisés surtout par de généreux Américains qui gèrent admirablement les intérêts des étudiantes américaines. On y trouve le Foyer des Etudiants, 93, boulevard Saint Michel qui a un « club house » admirablement équipé en tout, y compris une infirmerie ; le Club des Jeunes Filles Américaines, rue de Chevreuse, très confortablement situé dans une rue tranquille avec un magnifique jardin et Trinity Lodge, rue du Val-de-Grâce, sous les auspices de l’Eglise Anglicane, très agréablement installée. Tous ces clubs peuvent héberger un nombre limité de jeunes filles américaines et anglaises, et offrir un centre social général avec tout ce qu’il faut pour un nombre encore plus grand . (Science and Learning in France, 1917)
10: Foyer International,
93 boulevard Saint MichelGrace Whitney Hoff créa le centre de l’Association Chrétienne Franco-Britannique des Jeunes Femmes rue de Turin en 1906. Le Foyer fut transféré 93 boulevard Saint Michel après la Première Guerre Mondiale, hébergeant des jeunes étudiantes de toutes nationalités, s’appelant donc « le Foyer International ». Il fut démoli puis reconstruit en 1928 dans des locaux beaucoup plus vastes et donné à l’Université de Paris en 1936.
Mme. George Munroe et Anne Vanderbilt
11: La Loge de la Sainte Trinité et l’Hôpital Américain,
4 rue Pierre Nicole
« La Chapelle de Saint-Luc, sous les auspices de l’Eglise Episcopalienne de la Sainte Trinité a depuis des années consacré la responsabilité du suivi religieux et moral des jeunes américains, son Club des Etudiants et des Artistes au 107, boulevard Raspail étant un centre actif. Avec quatre mille étudiants américains tous les ans dans les écoles d’art et de musique de Paris et à la Sorbonne, il y a grand besoin de ces deux types de travail géré par les deux églises américaines. (Joseph Cochran. Friendly Adventurers, 1931)
* * * * * * *
« L’église s’est agrandie dans la Loge de la Sainte Trinité, rue Pierre Nicole de l’autre côté de la Seine, où il y a une chapelle pour les services ; une école industrielle dont Madame George Munroe est la directrice ; un hôpital ; des salons de lecture et une bibliothèque de prêt ; des classes pour des cours de français après les cours donnés à la Sorbonne ; des cours de littérature française et d’histoire ; des cours et une soirée musicale par semaine.
« La Loge de la Sainte Trinité et l’Hôpital Américain, 4, rue Pierre Nicolle (…) est le seul hôpital américain de la ville de Paris. Fondé en octobre 1905, en liaison avec notre église (…) Pendant les quatre ans et demi de son existence il a reçu et suivi deux-cent-vingt-cinq patients traités dans l’hôpital et trois cent vingt dans la clinique soit un total de cinq cent quarante cinq (…) Il a neuf lits et son centre chirurgical, etc répond aux nécessités d’aujourd’hui.(Le Parish Kalendar, 6 janvier 1910) (quelques piques peu charitables dirigées envers l’Hôpital américain de Neuilly-sur-Seine nouvellement ouvert, situé à l’extérieur de Paris, dans la banlieue ouest de Neuilly-sur-Seine et qui, à l’époque de la rédaction de cet article, avait été inondé par les grandes crues de la Seine, en janvier 1910).
Ouvrons ici une parenthèse pour des raisons pratiques, en faisant un saut en avant dans notre histoire pour un petit détour vers l’hôpital militaire de Paris.
12: Val de Grâce Hospital,
boulevard Port-RoyalLe médecin général, questionné sur l’admission de ces blessés allemands dans notre hôpital plutôt que de les envoyer au Val-de-Grâce, répondit qu’il n’avait pas eu le choix ; que les hommes avaient été conduits pendant la nuit par Monsieur Robert Bacon, ancien ambassadeur en France. [...]
En 1919, Monsieur Herrick déjeuna avec moi dans une villa que j’avais louée à Montecito, aujourd'hui dans l'enceinte de l'hôtel Biltmore et qui était à l’époque le Park Montecito. Après déjeuner il me dit « Docteur, je ne vous ai jamais maltraité sauf une fois, n’est-ce-pas ? mais je l’ai fait une fois et maintenant que l’histoire peut être racontée, je veux que vous sachiez tout. Le Secrétaire d’Etat, Monsieur Bryan, était très irrité sur notre Hôpital Américain à Neuilly ; il considérait que le fait que nous l’entretenions et le financions était un acte non neutre ; qu’à partir du moment où il était considéré comme une branche militaire de l’hôpital américain de Paris qui reçut ensuite une charte constitutive du Congrès des Etats-Unis, c’était pratiquement une interférence dans la Guerre par une création reconnue du Congrès des Etats-Unis ; que le Congrès avait donc le pouvoir de révoquer la Charte de l’Hôpital Américain et donc que l’Hôpital devrait fermer. Etait-ce une simple menace ou était-ce fondé, je ne le savais pas mais je décidai en mon fort intérieur de ne courir aucun risque sur ce qu’une Administration ultra neutre pourrait faire. Je dis donc à mon attaché militaire « J’aimerais avoir deux soldats allemands blessés pour notre Ambulance à Neuilly ; est-ce possible ? » « Très facile », dit-il « ils sont allongés partout le long de la route à quelques miles d’ici » « Parfait » dis-je « quand il fera nuit, prenez ma voiture, sortez et trouvez-en deux et ramenez les à l’Ambulance » . Robert Bacon était au bureau à ce moment-là et dit « Je vais avez lui ». Ils trouvèrent leurs prisonniers, les ramenèrent à l’Ambulance et les mirent en sûreté comme vous le savez. Quand je reçus leur rapport disant que l’obscurité avait fait son œuvre, j’adressait un câble au Département d’Etat « Hôpital neutre, avons des Allemands blessés ». Çà c’était la vraie diplomatie » (Samuel N. Watson. Those Paris Years, 1936)
Reprenons le cours de notre visite des hauts lieux de l’expérience estudiantine américaine sur la Rive Gauche.
13: Reid Hall,
4 rue de la ChevreuseAu cours de l’automne 1889, un couple proche de l’Eglise Américaine commença à organiser des réunions d’étudiants dans leurs appartements du Quartier Latin. Cette initiative fut agréée par les Episcopaliens et conduisit à la création de « chambres de lecture » et à la fondation de la Chapelle Saint Luc, d’abord dans un appartement puis, en 1892, dans un bâtiment métallique préfabriqué construit dans un jardin près de l’Institut Keller rue de Chevreuse. L’année suivante, Mme. Whitelaw Reid, femme de l’ambassadeur, travaillant en collaboration avec le pasteur de l’Eglise de la Sainte Trinité, le Dr. Morgan, alla au-delà des chambres de lecture en transformant l’immeuble de l’Institut Keller en une résidence pour les étudiantes américaines.
Sous le ministère de l’honorable Whitelaw Reid (…) Mme. Reid transforma un vieux bâtiment Louis XIII en une résidence étudiante pour femmes. Le Docteur Morgan y fit construire une chapelle couvert de lierre appelée Saint Luc du Jardin, mais que l’on appelait affectueusement dans le quartier « la Petite Eglise en Tôle ». Elle fut consacrée en novembre 1892 » Frederick W. Beekman, "A Centennial Day Address", July 6, 1947.
* * * * * * *
Ernest Shurleff était l’une de ces rares âmes dont les qualités spirituelles apparaissent dans tous leurs faits et gestes sans la moindre trace de piétisme. Naturellement timide et réservé, il ne s’imposait jamais à l’attention des autres, mais la présence de sa nature profonde et tranquille avait la force d’une marée montante. Il était particulièrement compétent pour travailler parmi les artistes car il vivait dans le monde de la beauté. Pour lui la Nature était la livrée du Saint Esprit. Ses merveilleux talents comme musicien et poète avaient été consacrés à la cause de la religion. S’il s’était spécialisé dans la musique ou la littérature, il se serait fait un nom pour lui-même. Mais il avait choisi le ministère du Christ et soumettait son art à son appel suprême
Souvent lors des réunions avec les étudiants, il jouait quelques morceaux de piano et prononçait quelques mots. Pendant la semaine, on le trouvait dans les studios, parfois peignant avec les étudiants. Ses réunions dans le grand atelier de l’Ecole Spéciale d’Architecture 254, boulevard Raspail étaient célèbres pour leurs programmes musicaux et leur atmosphère amicale. L’amphithéâtre pouvait recevoir quatre cent places mais souvent les couloirs voisins étaient remplis par ceux qui n’avaient pas pu y accéder. Une ou deux fois par mois, on donnait dans l’appartement des Shurtleff des « chez soi » où près de cent cinquante étudiants se réunissaient.
Mais les réunions publiques n’étaient que des obligations du travail, l’essentiel étant les contact personnels avec chaque étudiant. « Je ne pourrai jamais oublier comment Monsieur Shurtleff est venu à mon secours à Paris » dit l’un d’entre eux. Sa gentillesse et sa compréhension permettaient les confidences, et nombre d’étudiants au cœur brisé et sans ressources quittaient sa présence avec un courage renouvellé et de l’espoir. Un grand nombre furent sauvés du désespoir et même du suicide » (Joseph Cochran. Friendly Adventurers, 1931)
Pour voir à quoi ressemblaient les ateliers où travaillaient les jeunes artistes, une visite au Musée Bourdelle s’impose...
14: Musée Bourdelle,
18 rue Antoine-BourdelleCe fut le studio de Emile-Antoine Bourdelle de 1885 à 1929, l’un des sculpteurs remarquables gravitant autour d’Auguste Rodin. Pendant un temps, il fut l’assistant de Rodin, donnant des cours à la fois dans le studio de la rue de l’Université et à cette adresse. On trouvait également dans ce cercle d’artistes Sara Morris Greene, une Américaine qui étudia avec Rodin de 1905 à 1912. Son fils, Jack Morris Wright, était un condisciple et ami proche de Pierre, fils d’Emile-Antoine Bourdelle.
313 E 43rd Street, New York
Pendant la guerre, Pierre suivit l’exemple de son ami plus âgé. Jack Wright était membre de l’unité AFS d’Andover, conducteur de camion dans la Réserve Mallet avant de s’engager dans l’aviation. La mort de Jack dans un accident d’avion ne détourna pas Pierre de devenir aviateur avant de se joindre, après la défaite de la France en 1940, aux ambulanciers AFS en Afrique du Nord et en Italie. A cette époque, il avait déjà émigré en Amérique où il poursuivait une carrière artistique. Pierre Bourdelle assistait le 8 février 1961 dans son uniforme AFS à l’inauguration de sa sculpture en aluminium, haute de 26 pieds, « The Spirit of International Understanding » qui allait décorer le nouvel immeuble Galatti dans la 43 ème rue Est à New-York jusqu’à sa vente en 1993.
15: Office national des universités et écoles françaises (ONUEF),
96 boulevard RaspailNotre visite sur la Rive Gauche se termine devant le site d’une association à but non lucratif qui allait jouer un rôle important à la fois dans les AFS French Fellowships et dans les échanges ultérieurs des établissements scolaires. La mission de l’ONUEF était de promouvoir à l’étranger les ressources des universités et écoles françaises tout en développant les échanges de professeurs et d’étudiants entre la France et les autres pays. Fondé en 1910, il fut particulièrement actif entre les guerres avant de perdre son importance après la Seconde Guerre Mondiale jusqu’à sa dissolution en 1980. L’ONUEF gérait les premières bourses internationales d’AFS en France.
L'Office National des Universités et Ecoles Françaises est devenu incontestablement le centre des relations intellectuelles et scientifiques avec les Etats-Unis. [...] L'échange des étudiants lui a été entièrement confié. En 1918 et en 1919, une de ses occupations principales a été l'envoi de boursières et de boursiers français en Amérique. Dans un mouvement d'admirable générosité, l'Association des Collèges américains [...] a offert à nos étudiantes, à nos lycéennes, à nos institutrices, un grand nombre de bourses. [...] On ne s'est pas borné là, on nous a offert pendant l'hiver de 1918-1919 des bourses pour nos étudiants blessés de guerre ; l'Office des Universités en a envoyé trente-quatre. A la rentrée scolaire de 1919, vingt-neuf bourses ont été données à des étudiants français. Les unes sont dues à des Universités, à des Collèges et à des Instituts techniques ; les autres ont été fondées par l'Association des Etudiants américains accueillis dans les Universités françaises pendant la période de démobilisation. [...]
Mélanger ainsi nos jeunes compatriotes à la jeunesse américaine, qui est d'éducation et de moeurs si différentes, était une opération assez délicate. On a pris des précautions, on a donné les conseils nécessaires ; tout s'est en somme très bien passé. Une belle oeuvre a été faite et va être continuée. Elle ne contribuera pas seulement à rapprocher deux jeunesses, à dissiper quantité de préjugés, à ouvrir des intelligences et à unir des coeurs. (C. Petit-Dutaillis, Relations universitaires de la France avec les Etats-Unis, 1919)
Chapitre Trois
Table des matières