AVANT 1914 :
VERS UNE SOLIDARITE SANS FRONTIERES


En Europe, la notion de fraternité sans bornes a évolué dans le contexte d'un idéalisme chrétien : le mythe du Bon Samaritain.
25. Et voilà qu'un légiste se leva et lui dit pour le mettre à l'épreuve: Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?
26. Il lui dit : Qu'est-il écrit dans la Loi ? Qu'y lis-tu ?
27. Il répondit : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton esprit, et ton proche comme toi-même.
28. Il lui dit : Bien répondu ! fais-le et tu vivras.
29. Mais il voulut se justifier et dit à Jésus : Et qui est mon proche ?
30. Jésus reprit : Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il est tombé au milieu de bandits qui, après l'avoir dévêtu et couvert de plaies, s'en sont allés en le laissant à demi mort.
31. Un prêtre qui par hasard descendait par ce chemin-là l'a vu et s'est écarté.
32. Et pareillement un lévite en arrivant près du lieu l'a vu et s'est écarté.
33. Mais un Samaritain qui était en voyage est arrivé près de lui, l'a vu et s'en est ému ;
34. il s'en est approché et a bandé ses blessures en y versant de l'huile et du vin ; il l'a fait monter sur sa bête, l'a mené à l'hôtel et a pris soin de lui.
35. Et le lendemain il a tiré deux deniers et les a donnés à l'hôtelier en disant : Prends soin de lui et, ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour.
36. Qui de ces trois te semble avoir été le proche pour la victime des bandits?
37. Il dit : Celui qui a pratiqué la miséricorde envers lui. Et Jésus lui dit : Va et fais pareil.
( L'Evangile selon Luc, X, 25-37.)

1.2 Dans les traces du "Bon Samaritain"
Au Moyen Age, le chevalier errant et les ordres charitables incarnaient ce mythe. Les frères brancardiers ramassaient les blessés sur les champs de bataille. Les soeurs de charité soignaient les malades dans des hospices. Puis vint la Révolution avec son rejet de la noblesse, du clergé et de leur autorité. Au XIXe siècle, avec la marginalisation des institutions catholiques françaises, le flambeau du Bon Samaritain devait être repris par des protestants étrangers, vecteurs de nouveaux idéalismes : l'apparition d'ambulances civiles en temps de guerre, l'évolution de la profession de l'infirmière.
L'histoire de l'American Field Service commence donc en France avec les nouvelles formes d'expression du mythe du Bon Samaritain venues de l'étranger. Il en était temps.
Avant les révolutions de la fin du XVIIIe siècle, les conflits internationaux se résumaient à des combats entre petites armées professionnelles. Avec la conscription et l'avènement de grandes armées munies d'effroyables moyens de destruction, tout allait changer : l'aide médicale traditionnelle aux soldats allait s'avérer totalement inadéquate.
Le développement prodigieux donné récemment au matériel de guerre, l'introduction dans les armées du canon rayé et de la poudre comprimée, l'emploi d'une artillerie plus lourde et plus destructive ont grandement aggravé les horreurs du champ de bataille et rendu plus terrible que jamais le fléau de la guerre, déjà si terrible en tout temps. Cet accroissement des forces employées à détruire est entré comme élément de calcul dans les spéculations des philanthropes, qui voudraient fixer l'époque à laquelle, la guerre devenant un fait de plus en plus exceptionnel, la paix sera la condition normale d'une civilisation plus juste et plus humaine. Quelques plausibles et bien fondées que puissent nous sembler ces espérances, il est douteux, après les douloureuses expériences de la grand lutte américaine et du récent conflit dano-allemand, que l'ère désirée d'une entente cordiale et d'une affection mutuelle entre les nations soit autre chose qu'un rêve et une utopie, aussi longtemps que les passions des hommes et l'antagonisme de leurs intérêts resteront ce qu'ils sont aujourd'hui. Toutefois, au milieu de ces incertitudes, un coeur bienveillant peut tirer quelque soulagement de la doctrine des compensations, qui paraît exercer dans le monde moral une influence non moins universelle que celle de la gravitation dans le monde physique. Plus les mauvaises chances de mort et de blessures, avec leur terrible cortège de tortures et d'agonies, sont devenues nombreuses et redoutables dans les batailles modernes, plus aussi se sont multipliées les sympathies publiques, plus aussi s'est développée une volonté active et intelligente pour alléger les maux inséparables de la guerre et leur porter remède : plus les afflictions ont été grandes, plus les efforts entrepris pour en diminuer l'intensité ont été nobles et ingénieux.Ce mouvement de solidarité internationale humanitaire en temps de guerre, aussi civil soit-il, ne pouvait que subir l'influence des collaborateurs militaires.
(Thomas W. Evans, La commission sanitaire des Etats-Unis, son origine, son organisation et ses résultats, avec une notice sur les hôpitaux militaires aux Etats-Unis et sur la réforme sanitaire dans les armées européennes, E. Dentu, Paris, 1865, pp. i - ii.)
L'histoire des hôpitaux improvisés se rattache directement à l'histoire de la médecine militaire ; c'est à l'initiative d'un des membres les plus illustres du corps des officiers de santé de l'armée française qu'est dû l'emploi des hôpitaux sous toile et des hôpitaux baraqués en temps de guerre.Il est vrai de dire que, dans les diverses grandes guerres de ce siècle, les chirurgiens militaires, en raison de l'encombrement des hôpitaux-bâtiments, eurent recours à l'hospitalisation sous tente des blessés et des malades ; mais ce n'était là qu'une ressource extrême, un moyen exceptionnel, et, en dépit des bons résultats obtenus, l'usage de ces sortes d'hôpitaux ne fut jamais généralisé jusqu'à l'époque de la guerre d'Orient.
(Les ambulances de la Presse pendant le Siège et sous la Commune, 1870-1871, Marc, Paris 1872, p 202)

1.3 Les sociétés internationales de secours aux blessés militaires
C'est surtout à partir de la "guerre d'Orient" (la guerre de Crimée), que l'on entend parler des ambulances. (Au XVIIIe siècle, une ambulante était une petite table que l'on pouvait déplacer d'une pièce à l'autre). L'histoire des ambulances s'associe donc à l'évolution des services médicaux face au carnage des grands champs de bataille d'Europe et d'Amérique pendant la deuxième moitié du XIXe siècle.
En 1854-1855, pendant la guerre de Crimée, une Anglaise extraordinaire,
"la dame à la lampe", allait créer le mythe de l'infirmière moderne,
héroïne vêtue de blanc et non de noir, portant une croix rouge et non le
crucifix, à vocation professionnelle et non plus religieuse.
Du côté de l'Angleterre, miss Florence Nightingale ayant reçu un pressant appel de lord Sidney Herbert, secrétaire de la guerre de l'empire britannique, l'invitant à aller secourir les soldats anglais en Orient, cette dame n'hésita pas à payer de sa personne par un grand dévouement. Elle partit pour Constantinople et Scutari en novembre 1854, avec trente-sept dames anglaises qui dès leur arrivée, donnèrent des soins aux nombreux blessés d'Inkermann. En 1855, miss Stanley étant venue l'aider avec cinquante nouvelles compagnes, cette circonstance permit à miss Nightingale de se rendre à Balaklava pour y inspecter les hôpitaux. L'image de miss Florence Nightingale, la nuit, une petite lampe à la main, parcourant les vastes dortoirs des hôpitaux militaires, prenant note de l'état de chacun des malades, ne s'effacera jamais du coeur de ceux qui furent les objets ou les témoins de son admirable charité dont la tradition restera gravée dans l'histoire.Particulièrement inspiré par l'idéalisme de Florence Nightingale et d'autres protestantes anglo-saxonnes (Harriet Beecher Stowe, Elizabeth Fry), l'auteur de ces lignes, Henry Dunant (1828-1910), avait été élevé dans la plus pure tradition du protestantisme suisse. Il avait déjà initié un mouvement qui allait aboutir à la création de la YMCA, alors qu'il se trouvait sur le grand champ de bataille de Solférino, en 1859. Ce Genevois, venu en "touriste", y fut confronté à la souffrance d'innombrables soldats blessés. Ayant constaté l'insuffisance médicale, il essaya d'y remédier tant bien que mal. Son livre, Un souvenir de Solférino, écrit quelques années après, secoua les consciences européennes.
(Henry Dunant, Un souvenir de Solférino, (1862), Amsterdam 1902, p. 63)
Le soleil du 25 juin 1859 éclaira l'un des spectacles les plus affreux qui se puissent présenter à l'imagination. Le champ de bataille est jonché de cadavres d'hommes et de chevaux. Ils sont comme semés sur les routes, dans les fossés, les ravins, les buissons, les prés, surtout aux abords du village de Solférino.Dunant sut communiquer la force de ses convictions. Dès 1863, grâce à ses efforts, des Sociétés internationales de secours aux blessés de guerre s'organisèrent. Ce mouvement humanitaire aurait pour symbole la croix rouge sur fond blanc. En 1864, les signataires de la Convention de Genève entérinèrent le principe de neutralité --- symbolisé par ce fond blanc --- qui guiderait et protégerait de tels services médicaux civils et volontaires.[...45 pages de description suivent...]
Mais pourquoi rappeler tant de scènes de douleur et de désolation et causer ainsi des émotions pénibles ? Pourquoi raconter, avec complaisance, des détails lamentables et s'étendre sur des tableaux désespérants?
A cette question bien naturelle, nous répondons par une autre question.
N'y aurait-il pas moyen de fonder, dans tous les pays de l'Europe, des Sociétés de secours qui auraient pour but de faire donner, en temps de guerre, par des volontaires des soins aux blessés sans distinction de nationalité ?
(Henry Dunant, op.cit., pp. 15-60)

Dans le même temps, de l'autre côté de l'Atlantique, une guerre civile
sanglante battait son plein : la Guerre de Sécession (1861-1865).
Le service médical des armées était si mal organisé, si absolument insuffisant pour faire face aux nécessités les plus pressantes, que pendant la première année de la guerre, une large part de ses fonctions incomba forcément à la commission sanitaire.La Commission sanitaire se fit connaître partout en territoire nordiste, grâce à ses vastes campagnes financières, les foires sanitaires.
[...]
La commission sanitaire était une admirable institution née de la guerre. Comme Minerve sortit tout armée du cerveau de Jupiter, la commission était sortie tout organisée du cerveau du révérend docteur Bellows, ministre de l'église unitarienne de New York. Le docteur Bellows conçut le premier l'idée de concentrer, dans une vaste unité d'administration et d'action, les associations éparses qui s'étaient spontanément organisées pour venir en aide au service médical aux armées, mais dont les efforts isolés se traduisaient plus en bonnes intentions qu'en grands résultats.
(R. de Trobriand, cité dans R. Lemaître, La guerre de Sécession en photos, Séquoia, Paris, 1975, p. 162)
L'institution de la Commission sanitaire des Etats-Unis marque une période nouvelle dans l'histoire du monde. C'est l'acte de philanthropie le plus grandiose que l'humanité ait jamais médité et accompli. Par son influence, la société tout entière des Etats-Unis a été modifiée. C'est la grande pensée qui préoccupe l'attention publique presque exclusivement à toute autre. J'en ai eu les preuves les plus convaincantes dans un voyage tout récent que j'ai fait dans ma patrie, ma visite ayant spécialement pour but d'étudier les conditions hygiéniques des armées américaines et l'organisation de la Commission sanitaire.Ce furent donc ces deux grands mouvements humanitaires --- celui de la "Croix rouge", dont l'internationalisme était protégé par le principe de neutralité, et celui de la Commission sanitaire américaine, dont le succès était basé sur un grand soutien populaire, qui créèrent les conditions nécessaires à la conception et à l'élaboration en France d'un service d'ambulanciers volontaires américains.
(Thomas W. Evans, op.cit., p xi)
Ajoutons que l'influence de la Commission sanitaire a dépassé les frontières des Etats-Unis. En Europe, l'attention publique a été mise en éveil. C'est ainsi que dans le récent conflit dano-allemand, des comités de secours, régulièrement organisés d'après le modèle exact de ceux qui existent en Amérique, ont rendu les plus grands services.
(ibid, p xiii.)

Durant les années 1860, la colonie américaine de Paris était en contact intime avec les deux mouvements. Cette communauté regroupait des commerçants, des banquiers et des hommes d'affaires plutôt prospères, assez "rive droite", qui côtoyaient l'élite de la capitale. L'Eglise américaine, rue de Berri et l'Eglise de la Sainte-Trinité, avenue de l'Alma, servaient de lieu de rencontre à certains. D'autres se fréquentaient dans les coulisses des circuits banquiers et diplomatiques américains. En 1870, lors du siège de Paris, cette colonie créa la première Ambulance américaine, grâce aux efforts de Thomas Wiltberger Evans (1823-1897).
Evans avait quitté sa Philadelphie natale pour Paris, en 1847. Jeune, il avait manifesté plus d'intérêt pour la vie pratique que pour les études, déclarant à ses parents que son rêve était de "devenir mécanicien, savoir se fabriquer des choses." C'est ainsi qu'il choisit d'être apprenti-orfèvre.
Pendant plusieurs années, il travailla l'argent, apprenant à façonner
des objets, du cure-dents au service à thé. Pendant sa période
d'apprentissage, il fit connaissance avec des dentistes qui faisaient
appel aux services de son atelier. Peu de temps après, il façonnait
ressorts et appareils en or, en argent et en platine, ainsi que des jeux
d'instruments dentaires à manches de nacre. Ce contact avec les grands
dentistes de la ville le poussa à faire des études de médecine dentaire.
A dix-huit ans, il était étudiant à la clinique du docteur John DeHaven White, avec qui il resta deux ans. Par ailleurs, en 1844, il suivit des cours à l'Institut Médical de Philadelphie, assista en 1845 aux cours du docteur James Bryan sur la pratique chirurgicale et fit en même temps une année d'études au Jefferson Medical Collège. Il fit un internat de courte durée à Baltimore et ensuite exerça deux années avec le docteur William Van Patten à Lancaster, Pennsylvanie, où il se forgea une réputation d'expert dans l'utilisation de feuilles d'or pour les plombages.
(Milton B. Asbell, "A Century of Dentistry"", A History of the University of Pennsylvania School of Dental Medicine, 1878-1978, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 1978, p. 47)
En 1847, la démonstration de son talent lui valut d'être lauréat du
Concours de l'Institut Franklin pour l'innovation en pratique
dentaire. C'est ainsi qu'il se fit remarquer par un collègue du
docteur Brewster, dentiste américain établi à Paris et à la recherche
d'un assistant. Avant la fin de l'année, Evans était à Paris, se
joignant à d'autres jeunes dentistes américains, tous prêts à partir à
l'assaut d'un marché français où officiait un nombre non négligeable de
charlatans!
Au printemps 1850, un message urgent arriva à la clinique, sommant le docteur Brewster de se rendre au plus vite à l'Elysée, où le prince-président Charles-Louis Napoléon souffrait de terribles douleurs dentaires. Le docteur Brewster étant malade, Evans fut chargé de s'y rendre. On le guida vers les appartements privés de Louis-Napoléon. S'il s'attendait à voir Brewster, le prince-président eut la courtoisie de ne pas se plaindre quand il aperçut ce jeune homme enthousiaste. Evans le soigna pendant près d'une heure et réussit à calmer la douleur. Sa manière, douce mais attentive aux détails, fit forte impression sur son patient. Sur le point de partir, Evans se fit apostropher par Louis-Napoléon: "Vous êtes jeune, mais astucieux. Vous me plaisez." Evans devait revenir le lendemain. A partir de cette date, Evans continua ses visites professionnelles auprès de Louis-Napoléon à raison d'une à deux fois par semaine jusqu'à la fin du Second Empire en 1870.Le bon docteur était un homme d'initiative.Professionnelle, cette relation était aussi amicale. Louis-Napoléon admirait la confiance et les manières sociales directes de son ami américain à qui il confia des responsabilités politiques des plus secrètes et délicates. Evans fut nommé dentiste attitré de la Cour impériale, au même titre qu'un médecin. Ce nouveau statut l'amena à soigner de nombreuses autres têtes couronnées d'Europe. C'est ainsi qu'Evans acquit sa réputation de "dentiste américain".
(ibid, p. 48)
L'activité professionnelle d'Evans a été importante. Il a préconisé un amalgame d'étain et de cadmium qu'il dut abandonner dans la suite. Il vulgarisa la prothèse en caoutchouc vulcanisé et inventa un occluseur rectificateur pour améliorer l'articulation des dentiers doubles. Il contribua à introduire à Paris l'anesthésie générale au protoxyde d'azote dont Préterre fut un très actif propagandiste. Certaines de ses aurifications ont duré plus de vingt ans. Il s'est également intéressé à la préparation de la pyroxiline, base de la celloïdine (collodion durci employé à la fabrication de dentiers).Mais son enthousiasme ne se limitait pas à sa vie professionnelle. Il monta le premier journal américain de Paris, l'American Register (ce qui l'amena à fréquenter le cercle des intimes de Stéphane Mallarmé). Il était également très engagé dans les activités de l'Eglise américaine pour qui il trouva un site où construire son temple, rue de Berri. Plus tard il en fit autant pour l'Eglise de la Sainte-Trinité. Par le biais de ses relations dans l'entourage de Louis-Napoléon, Evans contribua financièrement au Service de santé militaire pendant les campagnes de Crimée et d'Italie (ce qui lui permit d'apparaître en tenue de service sanitaire lors de certaines cérémonies officielles). Lorsqu'il s'agissait d'inviter des Américains à la Cour, on lui demandait conseil. Louis-Napoléon avait l'habitude d'envoyer ses amis personnels en mission secrète. Evans se vit donc chargé de rendre visite au président Lincoln, afin que l'empereur pût décider s'il était opportun ou non de reconnaître officiellement les Etats sudistes. Evans profita de ce séjour pour effectuer une étude sur la Commission sanitaire.
(Dechame et Huard, Histoire illustrée de l'art dentaire, Dacosta, Paris 1977, p 603)
De retour à Paris, le docteur Evans informa Louis-Napoléon qu'il était "entièrement convaincu que la fin de la guerre n'était pas loin." L'Empereur se souvint après que "lorsque le plan de campagne élaboré par Grant et Sherman m'avait été communiqué, je me rendis compte, en consultant mes cartes d'état major, que c'était le début de la fin." Le docteur put ainsi rapporter au ministre des Affaires Etrangères, "J'ai conversé continuellement avec des personnes qui jouissent de la confiance de l'Empereur et je suis pleinement convaincu que maintenant il n'existe aucune idée de reconnaissance.
(Gerald Carson, The Dentist and the Empress, Houghton Mifflin, Boston 1983, p. 90)
Ayant étudié de près ce qui avait été accompli dans le domaine de l'aide sanitaire lors de la Guerre de Sécession américaine, le docteur Evans s'entretenait avec l'Empereur Napoléon et bien souvent avec l'Impératrice Eugénie, exposant ses théories et observations.Les relations amicales qu'Evans entretenait avec le couple impérial ont sans doute influencé le soutien qu'accorda Louis-Napoléon à l'oeuvre d'Henry Dunant : la création de sociétés internationales de secours aux blessés de guerre.
(...)
Encouragé par Eugénie qui s'intéressait peu aux batailles et aux sièges mais qui était sensible à la souffrance humaine, Evans utilisait tout son temps libre à travailler avec acharnement sur un manuscrit important. Celui-ci prit forme à l'automne 1864, donnant une description détaillée de l'organisation et l'oeuvre de la Commission sanitaire américaine : il s'agissait d'une association de citoyens volontaires dont le travail complétait celui du Bureau médical de l'Armée, mais sans l'aide du gouvernement. Pour la première fois dans l'histoire, soulignait Evans, la santé et le bien être des soldats communs suscitaient une attention particulière.
(...)
En 1865, le docteur faisait éditer son livre dont le titre, d'une longueur exagérée, exprimait avec exactitude sa pensée : La commission sanitaire des Etats-Unis: son origine, son organisation et ses résultats: avec une notice sur les hôpitaux militaires aux Etats-Unis et sur la réforme sanitaire dans les armées européennes.
(ibid, pp. 92-93)
Cette idée allait bientôt faire ses preuves.
En 1867, conjointement à l'Exposition universelle, une convention internationale des "sociétés de secours" se tint à Paris. Plusieurs pays apportèrent du matériel de secours médical. Les Américains exposèrent même une ambulance, témoignage de leur expérience sur les champs de bataille de la guerre de Sécession.En juin 1866, éclata la guerre entre la Prusse et l'Autriche.
Le vieil Empire autrichien a des lenteurs solennelles : il n'y a point encore, à Vienne, de Société de secours aux blessés; le gouvernement n'a point encore adhéré à la Convention de Genève. Il en va tout autrement du côté prussien. Les sociétés de la Croix-Rouge y sont admirablement organisées ; la Convention de Genève est connue de tous. On va donc voir la différence. Elle est éclatante. D'un côté, un Service de santé insuffisant ; de l'autre, des médecins et des infirmiers militaires auxquels viennent s'ajouter de nombreuses équipes parfaitement formées et admirablement équipées. Le gouvernement prussien fait appliquer à la lettre la Convention de Genève, sans exiger de réciprocité de la part de l'ennemi. Le bilan s'inscrit en vies humaines. Il est si éloquent qu'avant même la fin de cette guerre de sept semaines, l'Autriche adhère à la Convention de Genève.
(Pierre Boissier, Henry Dunant, Genève 1974, pp. 16-17)
"Déjà en 1865," dit Evans, "j'avais l'idée de rassembler, à mes propres frais, une collection des inventions ayant permis à la Commission sanitaire d'obtenir ses merveilleux résultats." Selon les estimations d'Evans, les efforts des "Sanitariens" américains avaient sauvé la vie d'une centaine de milliers d'hommes. Le docteur Evans prit donc contact avec inventeurs et fabricants aux Etats-Unis et envoya son ami, le docteur Crane pour s'occuper de la sélection et de l'envoi des objets. Le résultat fut une impressionnante collection de livres médicaux, de documents, de photographies, d'appareils et de matériel exposant l'oeuvre de la Commission sanitaire.Evans pouvait mener à bien son oeuvre philanthropique grâce à une fortune accumulée à la suite d'astucieuses spéculations immobilières fondées sur une connaissance privilégiée des projets du baron Haussmann. Il possédait ainsi une magnifique maison à l'angle des avenues Impératrice (aujourd'hui Foch) et Malakoff. C'est là où, après la défaite de Louis-Napoléon à Sedan et la chute du second Empire, l'Impératrice vint se réfugier.La Commission avait prévu de participer à la grande exposition universelle de Paris en 1867, mais le gouvernement américain refusa de coopérer. Pour combler ce vide, le docteur Evans se présenta avec sa collection. La France lui accorda une place dans l'exposition, Evans se chargeant des frais de transports à partir des Etats-Unis ainsi que de la construction d'un bâtiment sur le site du Champ-de-Mars.
(Gerald Carson, op.cit., p. 98)
Mais l'impératrice ? De bonne heure, le 4, elle a entendu la messe et prié dans son oratoire, visité les blessés soignés aux Tuileries, puis reçu Trochu, qui s'est enfin décidé à venir :"Madame, lui dit-il, voici l'heure des grands périls. Nous ferons ce que nous devons." Il eût fort en peine de dire quoi.
Elle préside ensuite un conseil assez incohérent où les uns lui proposent d'abdiquer en faveur de l'assemblée élue, les autres de mater cette révolution grondante, ou de transférer le siège du pouvoir en province... Finalement, on retient un projet que le Corps législatif rejetera d'emblée. Eugénie, avec ses jumelles, observe la foule qui grouille à la Concorde. Elle demande au général Mellinet :
"Général, peut-on défendre les Tuileries ?"
- J'ai peur que non, madame.
- Surtout, qu'on ne tire pas, sous aucun prétexte. Je ne veux pas qu'une goutte de sang soit versée."[...]
D'un instant à l'autre, les grilles peuvent être forcées, le palais envahi. [...]
Alors elle embrasse la maréchale Canrobert et ses dames d'honneur, en larmes, met un chapeau, un manteau sombre, noue sous son menton les brides d'une capote noire, prend le bras de Metternich. On remonte dans les appartements pour traverser le Louvre par la galerie d'Apollon et l'escalier du musée égyptien et gagner la sortie du côté de la place Saint-Germain-l'Auxerrois. Nigra est auprès d'elle, avec Mme Le Breton, la soeur de Bourbaki.Sur le trottoir, des bandes de vociférants les frôlent, conspuant Badinguet et l'Espagnole. Alors, bizarrement, les deux ambassadeurs s'éloignent pour aller chercher une voiture ; Mme Le Breton prend peur, hèle un fiacre, y poussa sa souveraine et donne l'adresse d'un ami, Besson, conseiller d'Etat, boulevard Haussmann.
Elles ne trouveront pas Besson, ni de Piennes, chambellan, qui n'est pas non plus chez lui, avenue de Wagram. Eugénie pense à son dentiste américain, le docteur Evans, à l'angle des avenues Impératrice et Malakoff. Il est absent lui aussi, mais elles peuvent l'attendre dans sa bibliothèque où il les trouve à six heures.
"Je ne suis plus heureuse, lui dit-elle : les mauvais jours sont venus et on m'abandonne. Vous seul pouvez me sauver, me donner les moyens de passer en Angleterre."
Evans la sauvera. Avec l'aide de son compatriote, le docteur Crane, il lui procurera le lendemain matin un landau, et tous deux accompagneront les deux femmes voilées sur la route de Deauville. [...] A la porte Maillot, les Américains donnent leurs noms et le chef de poste les salue. On franchit Saint-Germain, Meulan. Evans va chercher du pain et du saucisson. Le Journal officiel annonce la République proclamée, et Trochu président du gouvernement. [...] On change d'équipage à Mantes, à Pacy-sur-Eure. On passe la nuit dans une pauvre auberge à la Rivière-Thibouville. Décidément personne ne les poursuit. On prend le train jusqu'à Lisieux, puis une autre voiture. Dans l'après-midi du 6, c'est Deauville, mais c'est la tempête, et les bateaux ne sortent pas. Par chance, un petit yacht, la Gazelle est à quai, appartenant à un officier anglais, Sir John Burgoyne. Carrément, Evans s'adresse à lui, lui demande de prendre à bord l'impératrice en détresse.
La mer est épouvantable, mais Lady Burgoyne insiste, trop heureuse d'offrir à Eugénie et à Mme Le Breton l'unique cabine dont elle dispose. Après une nuit de navigation périlleuse - la Gazelle faillit bel et bien disparaître dans les flots -, on entre dans la rade de Ryde. Ruisselants d'eau, les voyageurs ont peine à trouver un hôtel qui veuille les accueillir. Ils parviennent pourtant à gagner Hastings en chemin de fer. L'impératrice séjournera une douzaine de jours au Marine Hotel, puis s'installera à Chislehurst, à vingt minutes de Charing-Cross, dans une propriété qu'Evans a louée pour elle. Son fils ne tardera pas à l'y rejoindre, et, vers le milieu de mars, l'empereur, libéré de Wilhelmshöhe.
(Alain Plessis, De la fête impériale au mur des fédérés, Seuil Paris 1975, pp. 132-134)

1.6 La première Ambulance américaine
La veille de la déclaration de guerre, le docteur Evans provoqua une réunion des représentants de la colonie américaine à Paris. Vingt-cinq d'entre eux, réunis à son bureau, formèrent le Comité sanitaire international américain. Le docteur Evans fut nommé président et son collègue de longue date, le docteur Crane, secrétaire. Il commanda aussitôt dix tentes conformes aux normes de l'Armée américaine par l'intermédiaire de son ami, l'avocat new-yorkais Horace Ely. En réalité, Evans avait l'intention de créer un hôpital de campagne sous toile, mieux adapté que les églises et autres édifices publics traditionnellement affectés à la réception des malades et blessés. On décida de choisir un emplacement à Paris, sachant que les Allemands risquaient d'avancer rapidement, ce qui fut effectivement le cas.
(Carson, op.cit , p. 107)
Les Prussiens firent donc le siège de Paris. Encore une fois, ils respectèrent les termes de la Convention de Genève. (On compta parmi les volontaires de la Croix-Rouge du côté prussien [à Strasbourg] la célèbre infirmière américaine de la guerre de Sécession, Clara Barton, fondatrice, onze ans plus tard, de la Croix-Rouge américaine.)
Par contre, du côté français, la Convention de Genève semblait avoir été oubliée. Mais Henry Dunant, qui se trouvait alors à Paris, réussit à faire publier les termes de cette convention dans le Journal officiel puis dans les grands quotidiens de la capitale. Dès le lendemain, le secours aux soldats blessés devint à la mode : la ville, pavoisée de drapeaux blancs ornés d'une croix rouge, voyait apparaître une profusion d'ambulances volontaires. La plus estimée allait être celle du docteur Evans, qui avait mis son matériel à la disposition du docteur Swinburne, médecin sanitaire américain durant la guerre de Sécession.
Le prince de Bauffremont, patient du docteur Evans et ami de l'Impératrice, fit don d'un terrain mal drainé envahi par les mauvaises herbes. L'entrée du terrain donnait sur l'avenue de l'Impératrice, face à Bella Rosa [demeure du docteur Evans] à l'endroit où l'avenue amorçait une légère descente vers les fortifications. Les premières tentes furent érigées le premier septembre. Un immense drapeau américain fut emprunté à Bowles Frères et Cie, maison de banquiers américains, les journées ensoleillées de début septembre furent consacrées à l'installation des tentes et au graissage des roues de wagons ambulanciers. Des dames américaines, portant le brassard de Genève, parcouraient les grande rues de Paris, faisant la quête pour les blessés grâce à un petit sac attaché au bout d'une perche. Les gens aisés donnaient des napoléons d'une valeur de vingt francs, ouvriers et grisettes y allaient de quelques sous. Cependant, le gros des contributions fut le fait du docteur Evans. Ce dernier calcula, en 1873, que pendant la période du fonctionnement de l'ambulance, il avait tiré environ 1,25 million de francs, (soit 250.000 $US) de son compte à la banque Rothschild .
ibid, pp 107-108Le campement fut entouré d'une bordure de jeunes pins et sapins censés "purifier l'air" et des conifères furent plantés au beau milieu du terrain. Une ambiance lumineuse et gaie émanait de toutes ces tentes blanches, des stores multicolores, des allées de gravier et des plate-bandes fleuries, des orangers ou grenadiers plantés dans des bacs verts. Le drapeau de la Croix-Rouge et le pavillon américain flottaient au sommet de deux grandes hampes. On trouvait aussi un piano, plusieurs oiseaux chanteurs, un chat gris et noir, un chien jaune et quatre vaches.
Les installations attenantes comprenaient des baraques, une cantine, un lavoir, un dépôt, et divers bureaux dont un pour le chirurgien, un pour le comité, d'autres pour les volontaires et les dames qui étaient infirmières, ou qui cuisinaient, faisaient la lecture aux patients, leur écrivaient des lettres, les distrayaient avec des parties de dames ou de backgammon. Les wagons ambulanciers étaient le domaine de jeunes Américains enthousiastes qui faisaient office, selon Evans, de fil conducteur entre l'Ambulance et l'ensemble de la colonie américaine résidant à Paris. C'est souvent en chantant que ces jeunes hommes accomplissaient leurs tâches, surtout aux moments de plus grand danger. Ils interprétaient ainsi En marchant à travers la Géorgie au plus grand étonnement des soldats français et allemands, dont l'objectif immédiat était de s'égorger.
ibid, p. 109
Dans d'autres ambulances et hôpitaux, les blessés périrent en grand nombre en raison des mauvaises conditions sanitaires. C'était loin d'être le cas dans les tentes bien aérées de l'Ambulance américaine. Alistaire Horne raconte dans Le siège de Paris que certains officiers français portaient sur eux un carton précisant leur volonté d'être emmenés à l'Ambulance américaine en cas de blessure.
Dans l'ensemble, les ambulances parisiennes ne présentaient guère de progrès sur ce qu'on avait vu en Crimée et ce qui pouvait le plus ressembler à Florence Nightingale, c'était l'ambulance américaine, qui devait son existence au docteur Thomas Evans, l'élégant et entreprenant dentiste qui avait aidé l'impératrice Eugénie à fuir Paris. Après la grande exposition de 1867, il avait, pour on ne sait quelle raison, acheté toute la collection de matériel médical provenant de la guerre de Sécession et, au début des hostilités, il organisa une ambulance qu'il dota de tout ce matériel moderne, en donnant en outre dix mille francs. Le directeur en fut le docteur Swinburne, qui avait l'expérience de la guerre de Sécession. Celle-ci avait démontré que la façon la plus efficace de combattre la septicémie consistait à assurer une ventilation parfaite. Au grand étonnement des Français, avec leur horreur native des courants d'air, l'ambulance abritait ses deux cents blessés sous des tentes ouvertes, chauffées par un poêle central, enfoncé dans un trou, qui séchait et chauffait le sol au-dessous de la tente. Les résultats furent miraculeux : alors que quatre amputés sur cinq mouraient dans l'atmosphère purulente du Grand Hôtel, quatre sur cinq survivaient dans l'ambulance de Swinburne.
Les journalistes britanniques ne cessaient de chanter les louanges de celui-ci. Même le docteur Alan Herbert, qui opérait à l'ambulance de Wallace, admettait que celle des Américains était "une des merveilles du jour". Elle arrivait toujours la première sur le champ de bataille, d'après Bowles. Lors de la "Grande Sortie", elle ramena quatre-vingts blessés dont l'un mourut entre les bras du fils de Washburne ; dans un engagement ultérieur, une de ses voitures fut touchée par des obus prussiens. Sa renommée s'enfla vite. "Le rêve de tout soldat français, écrivit Labouchère, est d'être transporté à cette ambulance s'il est blessé. Ils semblent avoir le sentiment que, même si leurs jambes sont arrachées, l'habilité des Esculape des Etats-Unis les fera repousser." Sans doute exagérait-il, mais l'efficacité de l'équipe Evans-Swinburne fut incontestable, et les Parisiens leur en eurent une gratitude infinie qui s'étendit aux Etats-Unis.
Alistaire Horne, Le siège de Paris, Plon, Paris, 1967, pp.146-147

1.7 Les premiers étudiants américains à l'étranger
Depuis longtemps, des étudiants se sont déplacés pour poursuivre leurs études ailleurs. Dans la dernière moitié du XIXe siècle, Paris devint la Mecque des jeunes Américains désirant parfaire leurs connaissances dans le domaine de l'art, que cela soit en peinture, sculpture ou architecture. Certains, bien entendu, se dirigeaient vers l'Italie ou l'Allemagne, mais à la fin du siècle, la prédominance de l'Ecole des Beaux-Arts et des ateliers de Paris était acquise.
La véritable ruée de jeunes hommes et femmes venus étudier l'art en France et particulièrement à Paris, ruée initiée sous le Second Empire et qui se tarira tout à fait avec la Seconde Guerre Mondiale, est un phénomène sans équivalent dans les autres disciplines. Cette attirance pour la France s'explique par la conjonction de nombreux facteurs : la richesse croissante des Etats-Unis et son désir d'entrer dans l'arène culturelle internationale, la promotion des arts en France sous Napoléon III, et enfin les incitations prodiguées aux plus jeunes par ceux qui en sont revenus. Si les Salons existaient bien avant Napoléon III, en revanche le Second Empire donne une nouvelle image de la France, luxueuse et moderne, patrie des arts et terre où la manne des commandes artistiques et achats de l'Etat semble se répandre comme nulle part ailleurs. Le prestige de l'Ecole des Beaux-Arts --- surtout après la réforme de 1863 --- surpasse peu à peu celui des Académies de Londres, Munich et Düsseldorf et attire les jeunes aspirants artistes d'Outre-Atlantique. Enfin, l'atmosphère créative de Paris d'Haussmann puis de la Troisième République qui se couvre de bâtiments nouveaux, de sculptures nouvelles ; le respect pour les métiers d'art ; l'attention portée par la public et les média aux expositions ; l'esprit d'émulation qui règne dans les écoles --- tout ceci enthousiasme des jeunes gens venus d'un pays où l'on n'accorde que mépris à l'art contemporain indigène.
Véronique Wiesinger, "Quelques idées générales", Le voyage de Paris, les Américains dans les écoles d'art 1868-1918; Editions de la Réunion des musées nationaux, Paris 1990 ; pp 13-14
Ces jeunes artistes américains furent les précurseurs des échanges interculturels. Originaires d'un pays en pleine expansion, ils venaient des couches privilégiées de la société américaine, francophiles pour deux raisons contradictoires : réaction à l'ancienne domination politique anglaise et conformité à leurs "cousins" anglais pour qui, historiquement, la France était synonyme de culture. Pendant les premières années de la nouvelle république des Etats-Unis, l'art autochtone se limitait à l'artisanat et à l'esthétique d'objets utilitaires. Les beaux arts, par contre, devaient être importés, d'où le souci des classes "cultivées" de retourner en Europe afin de parfaire leurs connaissances de l'art.
Le taux de change favorable et l'absence de frais de scolarité (exception faite d'une modeste allocation dans les ateliers "extérieurs" situés hors de l'enceinte de l'Ecole) encouragent les jeunes Américains à partir. Toutefois un long séjour à l'étranger représente un important investissement de temps et d'argent. La plupart de ces jeunes gens proviennent donc de milieux aisés ; certains font même partie de l'upper crust, comme Lloyd et Whitney (1864-1943) Warren, cousins des Vanderbilt.
Isabelle Gournay, "Les Etudiants américains en architecture à l'Ecoles des Beaux-Arts", dans Les Américains dans les Ecoles d'Art 1868-1918, Réunion des musées, Paris1990, p 49
L'enthousiasme francophile qui se généralisa ensuite chez certains
Américains est né non seulement de ce désir de découvrir la culture
européenne, mais aussi de la découverte de la culture française vécue
au quotidien.
Dans mes débuts à l'école j'étais le seul Américain de la classe, et c'est à cause de cela que j'adoptais peu à peu les manières françaises. Mes amis étaient tous des étudiants français et ma façon de penser, en art ou autre chose, était influencée par eux. Se mettre ainsi dans la peau d'une autre nationalité permet d'élargir beaucoup son point de vue, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je me félicitais de vivre en France.
William Sartain (1843-1924), dans une lettre de 1873, cité par Véronique Wiesinger, "Souvenirs de Paris", Les Américains dans les Ecoles d'Art, op.cit. , p. 26
Cette tendance commença à s'instituer pendant les dernières décennies du XIXe siècle.
Les bourses d'études ne sont créées que tardivement, et encore
sont-elles peu nombreuses (Alexander Phimister Proctor remporte la
première Rinehart Scholarship en 1896, et Willard Dryden Paddock la
première bourse du Pratt Institute en 1895).
Véronique Wiesinger, "Les élèves sculpteurs américains à Paris", Le Voyage de Paris, p 62

1.8 Les premiers échanges universitaires
Après la guerre de Sécession, les Etats-Unis, en pleine expansion
industrielle et forts de leur conquête de l'Ouest, devinrent une nation
moderne dont l'ambition se traduisit par la guerre hispano-américaine
de 1898. En France, sous la Troisième République, on commençait à
comprendre l'intérêt qu'il y avait à créer des liens avec cette
"république soeur". Nombre de ces liens se tissèrent par le biais de la
petite colonie américaine de Paris.
Un Comité franco-américain avait été organisé à Paris sous la direction du ministère de l'Instruction publique, en vue de créer des grades universitaires pour les étudiants américains à Paris. A une réunion chez le Dr. T.W. Evans, le 8 juillet 1895, il fut décidé de former un comité local d'Américains pour favoriser ce mouvement. Ce comité fut nommé "The Paris-American University Committee", à une rénions qui eut lieu chez le Dr. Evans le mercredi 19 juillet 1895. Evans fut nommé président de ce comité, créé pour coopérer avec le Comité franco-américain, pour aider à l'extension des privilèges universitaires français aux étudiants américains, et pour favoriser leurs intérêts dans leurs relations avec les universités de France. [...]A l'époque, l'élite du pays était en grande partie constituée de diplômés des grandes universités de la Ivy League, Harvard en tête. Ces universités, calquées sur le modèle anglais, donnaient une importance considérable à la solidarité entre anciens élèves. La francophilie des grandes universités américaines, malgré la présence de quelques professeurs allemands, aura une grande influence sur l'adhésion de l'élite américaine à la cause française, dès le début de la Grande Guerre.
Le débat continue tout le long de l'année 1896 et au delà. L'American Register, du 26 décembre 1896 : "Le Conseil universitaire, à sa réunion de lundi dernier [21 décembre] adopta une résolution, qu'un comité fût nommé pour étudier l'institution d'un diplôme à être conféré aux étudiants étrangers, plus spécialement aux étudiants américains, qu'ils puissent emporter comme preuve de leurs études et de leurs connaissances acquises à Paris". Toutes ces discussions devaient aboutir à la création du doctorat de l'Université de Paris.
Henri Mondor et Lloyd James Austin, La correspondance de Stéphane Mallarmé, Gallimard, Paris vol VII, p. 307
C'est à la fin du XIXe siècle et dans les premières années du XXe siècle que commencent à être mis sur pied les premiers échanges des professeurs d'université. Les premières initiatives sont parties de l'Université Harvard. Le "Cercle français" de cette université, constitué en 1886 pour jouer des pièces classiques, invite chaque année à partir de 1898, un conférencier français grâce à une fondation créée par un ancien étudiant de l'université, fortuné et très francophile, James Hazen Hyde. René Doumic, de l'Académie française, est le premier conférencier du cercle français de Harvard.
Y.H. Nouilhat, France et Etats-Unis, août 1914-avril 1917, Sorbonne, Paris 1979 ; p. 62

Déjà centre du monde médical au siècle des Lumières, la France se situait, à la fin du XIXe siècle, à la pointe de la médecine moderne, ceci grâce aux travaux de Claude Bernard (1813-1878), de Louis Pasteur (1822-1895) et de Pierre (1859-1906) et Marie (1867-1934) Curie. Néanmoins, ce type de soins n'était pas nécessairement accessible aux étrangers de passage en France ou aux étrangers sans ressources.
A Paris, les étrangers, isolés ou mal informés, sont ---involontairement --- tenus à l'écart de tels progrès. Parmi eux de nombreux Américains - étudiants, touristes, voyageurs, résidents - qui vivent dans le -- provisoire avec de petites économies ou de faibles revenus. Au début du vingtième siècle, on dénombrait à Paris, aux mois forts de l'été, jusqu'à cent mille Américains. Nombreux étaient ceux qui occupaient des chambres d'hôtel plus ou moins confortables, plus ou moins saines... Sur le plan sanitaire, le gouvernement américain n'avait rien prévu pour ses ressortissants en France. Aucune protection sociale ne pouvait leur venir en aide en cas de maladie. Dans les meilleurs cas, les Américains malades faisaient appel à des associations charitables, mais beaucoup essayaient de se soigner par leur propres moyens... ce qui, à l'époque, débouchait souvent sur de véritable drames.
Nicole Fouché, Le mouvement perpétuel, histoire de l'Hôpital américain de Paris 1906-1989, manuscrit inédit, pp 8-9.
En 1904, un médecin de la colonie américaine, le Docteur A.J. Magnin, et un de ses amis, Harry Van Bergen, conçurent l'idée de créer un hôpital américain. En 1906, le projet commençait à prendre forme avec l'appui de membres influents de la colonie. Personne dans ce groupe n'ignorait la réputation de la première Ambulance américaine. Certains connaissaient les oeuvres charitables des temples américains : le dispensaire pour étudiants américains de l'Eglise de la Sainte-Trinité et la Mission médicale montée par l'Eglise américaine entre 1881 et 1883.
En septembre 1881, une mission médicale est établie au 59 rue Letellier à Grenelle, sous la direction du docteur Henry R. Darcus. Le personnel se compose d'un prédicateur et de bénévoles. Deux fois par semaine, le docteur Darcus tient un dispensaire gratuit. Il prescrit des ordonnances à 300-400 personnes par mois.
Joseph W. Cochran, Friendly Adventurers, Brentanos, Paris 1931; pp. 110-111
Le Centre pour étudiants et artistes vit le jour en 1890, à l'époque du
dernier ministre plénipotentiaire en France, Whitney Reid, juste avec la
mise en place de l'Ambassade. En effet, Mme Reid souhaitait venir en
aide à ses jeunes compatriotes étudiant à Paris. Elle acheta une
propriété située entre les rues de Chevreuse et de la Grande Chaumière
et fit aménager la maison - un admirable vieux bâtiment datant de
l'époque de Louis XIII - en une auberge et un club destinés aux
Américaines, étudiantes ou artistes. Elle accorda également au
docteur Morgan, pasteur de l'église de la Sainte-Trinité, la permission
d'ériger sur cette propriété la petite chapelle de St
Luc-dans-le-Jardin, que des générations d'étudiants allaient surnommer
affectueusement "la petite église d'étain". En même temps, le
docteur Morgan fonda dans le voisinage l'Auberge de la Sainte-Trinité,
dotée d'une clinique ; l'auberge, sous la direction de la
diaconesse J Carryl Smith, et la clinique sous celle du docteur Crosby
Whitman. A cette époque lointaine, avant même l'existence de
l'hôpital américain à Neuilly, on peut facilement comprendre l'immense
valeur que représentait une telle clinique dans un pays étranger pour
des étudiants américains dont nombreux ne vivaient que de moyens très
modestes.
W.S. Scott, A Crusading Dean, Herald, Farnham 1967, p 61
A la veille de la fête nationale américaine du 4 juillet 1907, les
administrateurs de l'Association de l'Hôpital américain à Paris
passèrent à l'acte en achetant une propriété (y compris bâtiment et
dépendances) à Neuilly-sur-Seine, à l'ouest de Paris. Deux ans
après, ils auraient transformé le bâtiment en hôpital.
L'idée des fondateurs n'est pas de faire du profit. Au contraire, ils
souhaitent faire oeuvre de bienfaisance en offrant aux Américains de
France - voire d'Europe - qui le désirent, quel que soit leur revenu,
le bénéfice des derniers développements de la médecine et de la science,
gratuitement si nécessaire. Pour financer leur entreprise, ils
décident de faire appel, aux Etats-Unis et en France, à la générosité
légendaire du peuple américain.
Nicole Fouché, op.cit., p. 12
En septembre 1909, l'Hôpital est prêt. Le 28 octobre, Henry White,
ambassadeur des Etats-Unis en France, Gaston Doumergue, ministre de
l'Instruction publique française (futur président de la République), et
un certain nombre de représentants du corps médical et du monde
américain de Paris, assistent à l'inauguration de l'Hôpital. C'est une
magnifique réussite pour Van Bergen et Magnin.
ibid., p. 16
Après un retard dû aux inondations de janvier, l'Hôpital américain de Paris, rue Chauveau à Neuilly-sur-Seine, reçut son premier patient le 30 mars 1910.


Le 3 août 1914, la France se lançait dans la Grande Guerre. L'ambassadeur américain, Myron T. Herrick, entra en action dès le début des hostilités.
Longtemps avant la guerre un petit hôpital américain avait été organisé à Paris. Il était moderne, bien aménagé et avait une excellente direction. Il était destiné aux seuls Américains. Aussitôt après la déclaration de guerre les directeurs décidèrent d'offrir l'hôpital pour y soigner les blessés. Voici le récit laissé par M. Herrick :
"Dans les premiers jours de la guerre, alors que nous formions un comité pour soigner des Américains en Europe, le docteur Magnin, notre médecin personnel, vint un jour à l'ambassade et me suggéra d'aménager son hôpital pour y recevoir des blessés. Il me dit que tel était le désir des directeurs sur l'autorité desquels il s'appuyait. Il pensait que nous pourrions mettre des tentes dans le grand jardin afin de soigner un certain nombre de blessés ; j'approuvai son idée et nous allâmes rendre visite au docteur Février, directeur du Service de Santé. Celui-ci avait des idées larges et quand il entendit nos propositions il nous demanda si nous ne préférerions pas prendre le lycée Pasteur à Neuilly, pour y installer notre hôpital. Aucune des organisations de la Croix-Rouge ne pourrait se charger de cette fondation importante. Il pensait que nous autres Américains serions capables d'une telle entreprise. Nous lui dîmes que nous allions envisager la question. "[...]
"Dans les organisations officielles, un précédent est toujours utile pour parer à toute critique. C'est le cas pour notre ambulance. Un hôpital américain pour les blessés avait été créé à Paris pendant la guerre de 1870. [...] L'histoire de cet hôpital fut glorieuse et nous espérions l'égaler, mais nous ne nous doutions pas du long effort que nous aurions à fournir." [...]
"J'ai même entendu dire que des soldats anglais, avant d'aller à la bataille, avaient mis une note dans leur poche, demandant à être envoyés à l'ambulance américaine s'ils étaient atteints. Mais peut-être est-ce là une aimable exagération.
T.B. Mott, Souvenirs de Myron T. Herrick, Plon, Paris 1930; pp. 87-92
La "réincarnation" de la célèbre Ambulance américaine n'allait pas chômer. C'est ainsi que, jusqu'à la fin de la guerre, le lycée Pasteur, dont elle occupait le bâtiment, allait tenir ses cours dans diverses pensions et autres cafés.
Le Lycée de Neuilly, dont l'ouverture sous la direction du Proviseur Fleureau avait été prévue pour le 1er octobre 1914, fut transformé dès le début de la guerre 1914-1918, en hôpital militaire auxiliaire dont les Américains assurèrent le fonctionnement.
Jusqu'à l'entrée en guerre de l'Amérique, tout le personnel de cet hôpital fut composé de volontaires. C'est l'organisation qui existait quand, un jour du moi de juin 1917, on me transporta en assez mauvais état dans une classe du rez-de-chaussée donnant sur la rue Perronet. Nous étions là une douzaine de blessés gravement atteints (car on ne s'occupait en principe à l'ambulance américaine que des gens en valant vraiment la peine ! ) L'organisation matérielle était parfaite, une propreté méticuleuse régnait dans la place et dès sept heures du matin, on commençait à astiquer ! --- A chaque salle (en principe une classe), étaient affectés deux infirmières et un infirmier --- Ce luxe de personnel et de moyens était, bien entendu, inconnu des hôpitaux militaires français ; aussi étions-nous choyés et cela d'autant plus que notre état demandait plus de soins. Après l'enfer du front, c'était le paradis !
M. Lasserre, cité dans 1914-1989, Soixante-Quinzième Anniversaire du Lycée Pasteur, Lycée Pasteur, tirage privé, Neuilly-sur-Seine, 1989

Dès 1868, le docteur Evans avait identifié un obstacle majeur au soin d'un blessé de guerre, à savoir : l'inefficacité des moyens de transports routiers.
Dans tous les cas, le gaspillage d'énergie en wagons, chevaux et hommes est forcément considérable. Il est même démesuré dans la plupart des armées européennes, puisque dans la majorité des cas, il faut trois à quatre chevaux pour tirer une ambulance.
Thomas W. Evans, Report on Instruments and Apparatus of Medicine, Surgery and Hygiene; Surgical Dentistry and the Materials which It Employs: Anatomical Preparations; Ambulance Tents and Carriages, and Military Sanitary Institutions in Europe, Government Printing Office, Washington, 1868.
Cependant, la solution allait venir du développement du moteur à combustion.
La révolution la plus grande qui se soit produite dans le service de santé de première ligne est la substitution des voiture-automobiles aux voitures à traction animale avec lesquelles nous sommes entrés en campagne. Le branle fut donné par l'initiative privée. Le monde parisien, habitué au luxe des automobiles, s'émut de la pauvreté des armées. L'Automobile-Club, présidé par l'amiral Percin, se chargea de faire transformer en voitures ambulances deux cents voitures réquisitionnées par le ministère de la Guerre. L'Union des Femmes de France offrit de son côté douze châssis Panhard aménagés avec des appareils Lemaître. L'Amérique et l'Angleterre nous vinrent également en aide. [...]
Les types des voitures étaient un peu disparates au début ; les marques de différents noms. il est inutile de rappeler tous les essais qui ont visé à l'adoption du genre de voiture le plus commode au transport des blessés couchés et assis. C'est un matériel en incessante transformation qui peut aboutir demain à un degré de perfectionnement insoupçonné et duquel il est bon de n'avoir pas qu'un modèle. La campagne a montré quelles voitures légères de Ford se faufilent très aisément à l'avant et montent sans accroc jusqu'aux postes les plus avancés. C'est le type de voiture de première ligne.
A. Mignon, Le service de santé pendant la guerre 1914-1918, Masson, Paris; tome IV, p. 375
Les petites Fords nécessitaient surtout un bon conducteur.
Il restait au Service Automobile à remplir une tâche encore, la plus lourde et la plus grave peut-être, mais aussi la plus belle et la plus noble : l'enlèvement des blessés. Il se confiait à ses sections sanitaires. [...] Leur travail fut extrêmement pénible ; et, si l'existence de l'automobiliste du front a toujours été pleine de fatigue et exempte de confort, on peut dire que le conducteur de sanitaire eut le privilège de connaître, mieux encore que ses camarades, la vie de l'avant dans toute sa rigueur ; et c'est pourquoi le personnel de ces sections avait fini par constituer une véritable élite, dont les mérites, d'ailleurs, étaient reconnus, après chaque affaire, par un nombre imposant de citations.
C'est que les sanitaires, qui ne devaient aller, en principe, que jusqu'aux postes avancés des G.B.D. (groupes de brancardiers divisionnaires) montèrent chercher les blessés jusqu'aux postes de secours, dans des terrains marmités par l'ennemi, à travers, souvent, des tirs de barrage et des vagues de gaz, qu'il leur fallait franchir à découvert. Ajoutez à cela l'obscurité, les cris des blessés que les cahots mettaient au supplice, le masque, qui gênait terriblement pour conduire ! Et le conducteur, cependant, se rendait compte, plus que partout ailleurs, de l'importance du rôle qu'il jouait : ne tenait-il pas entre ses mains, constamment, la vie de centaines de blessés qu'il pouvait sauver par son sang-froid et sa promptitude ?
Paul Heuzé, "L'automobile dans la guerre", Illustration, n°3961, 1 fev 1919, p. 127
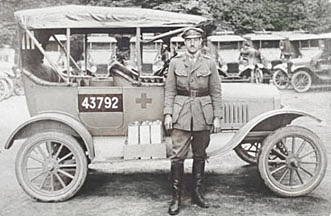
En août 1914, un service de voitures ambulances, l'American Volunteer Motor Ambulance Corps, était organisé à Londres par Richard Norton, achéologue réputé et fils du célèbre professeur Charles Eliot Norton de Harvard. Avec le concours des écrivains Edith Wharton et Henry James, des amis de son père, Norton associa son corps d'ambulanciers à la Croix-Rouge britannique et à l'Ambulance de St. John.
Henry James s'investit de la même façon au service de l'activité spécifiquement américaine qui s'organisait en Angleterre pendant les tout premiers jours de la guerre, avant même l'entrée en guerre des Etats-Unis qui aurait lieu après sa mort. James accepta de présider l'American Volunteer Motor Ambulance Corps en France. Richard Norton, fils de son vieil ami Charles Eliot Norton et ami de Mme Wharton, s'adonna à ce travail et James et Mme Wharton s'engagèrent à apporter leur aide. James écrivit une longue lettre à la presse américaine décrivant la nature de cette entreprise. Son but était d'informer, mais aussi de lancer un appel de fonds. Le Corps fut une des entreprises pionnières de l'ère du moteur.
Leon Edel, Henry James, New York 1972; p. 518
Londres, le 25 novembre 1914
M. Norton eut l'idée de cette remarquable entreprise quand, au début de la Guerre, il vit à l'Hôpital américain de Neuilly des vingtaines de blessés français et anglais qui mouraient ou qui devaient subir de longues infirmités ou souffrances ; une seule raison de cela : le délai incroyablement long d'enlèvement sur les champs de bataille.
Henry James, "The American Volunteer Motor-Ambulance Corps in France: A Letter to the Editor of an American Journal", Within the Rim, Collins, Londres; 1918, pp 63-4
Dès le mois d'octobre, une dizaine de ses voitures furent affectées au service d'arrière-front en France. Les chauffeurs volontaires avaient été recrutés dans des grandes universités américaines. Plus tard, suivant l'exemple de l'AAFS, le service de Norton serait rattaché aux unités de combat françaises. En 1916, l'American Volunteer Motor Ambulance Corps fusionna avec la Croix-Rouge américaine. Cette dernière avait été organisée en France par Herman Harjes, représentant de la banque Morgan, de la Croix-Rouge américaine et du Comité central de secours américain. (Harjes et son père avaient compté parmi les fondateurs de l'Hôpital américain). Le nouveau corps serait dorénavant appelé le service Norton-Harjes, et parfois, Morgan-Harjes.
Lorsque les Etats-Unis entrèrent en guerre, M. Norton avait la charge de plus d'une centaine d'ambulances sur le front occidental, et était en train d'organiser deux sections supplémentaires de quarante hommes chacune. On le pria d'accepter le grade de major dans l'Armée américaine et de continuer de diriger le corps d'ambulanciers qu'il avait dirigé et géré pendant deux ans et demi avec une dévotion inlassable et des résultats admirables. Norton refusa pourtant la proposition et en septembre 1917 se retira du service. Début août 1918, il mourut subitement à Paris, des suites d'une méningite.
E.W. Morse, The Vanguard of American Volunteers, Scribner's, New York 1918 ; pp. 127-128

Un groupe d'Américains influents prit en charge le nouveau bâtiment du lycée Pasteur de Neuilly, dont les travaux étaient presque terminés. Fin août, l'Ambulance américaine était prête, munie d' une modeste équipe sous la direction de deux éminents chirurgiens américains, Edmond L. Gros et Charles Du Bouchet.
Mme William K. Vanderbilt offrit les voitures pour le transport et M. Harold White, directeur de l'usine d'assemblage Ford à Levallois-Perret, non loin de là, fit le nécessaire pour aménager 10 châssis modèle T. Avec le concours d'un carrossier local, les rares hommes qui restaient à l'usine construisirent une carrosserie rudimentaire : un plancher en bois assez grand pour tenir deux brancards et une structure de lattes en bois recouverte de toile tendues. Une planche posée sur le réservoir d'essence servait de siège au chauffeur qui conduirait à ciel ouvert. Dès la première semaine de septembre, 10 de ces véhicules artisanaux se trouvaient dans la cour du lycée Pasteur. Chacun arborait sur les deux côtés une grande croix rouge avec la légende American Ambulance.
Une demi-douzaine d'ouvriers de chez Ford - Anglais, Américains, Français - s'étaient portés volontaires pour conduire ces véhicules et d'autres ne tardèrent pas à les rejoindre. L'auteur de ce récit, dont les pérégrinations touristiques avaient été brusquement interrompues par la guerre, entra par curiosité au lycée Pasteur le 7 septembre; 15 minutes après, il était ambulancier.
J. Paulding Brown, dans The History of the American Field Service, éditée par George Rock, Platen Press, New York 1956 ; p. 7
Les premiers ambulanciers de l'American Ambulance Field Service ramenèrent les blessés d'un front peu éloigné de Paris.
Ce fut le 6 septembre 1914 que le premier appel réclamant de l'aide vint du champ de bataille de la Marne. On fut averti qu'il y avait des centaines de blessés non soignés à Meaux. Un train d'ambulances automobiles fut envoyé en toute hâte par l'hôpital à Meaux. Dans Meaux déserté, 350 soldats blessés attendaient, soignés par quelques vieux paysans et l'archevêque, Mgr Marbot." Cinquante blessés furent ramenés immédiatement à l'hôpital de Neuilly et ce fut ainsi que s'ouvrit l'Ambulance américaine."
Paul-Louis Hervier, Les volontaires américains dans les rangs alliés, La Nouvelle Revue, Paris, 1917, p. 240.Les blessés de Meaux sont des tirailleurs africains (arabes ou noirs) : Tunisiens, Algériens, Marocains, Sénégalais. Ils ne connaissent en français que leur numéro matricule. Effroyablement choqués, ils endurent des souffrances physiques et morales indicibles. Leurs corps sont ensanglantés et mutilés... Après les premiers soins d'urgence, l'Ambulance les ramène vers Pasteur où les attendent les équipes chirurgicales. Il est clair que nombreux sont ceux qui ne survivront pas : morts pour la France. Ce sont les premiers de l'Ambulance. Il y en aura beaucoup, beaucoup d'autres.
Nicole Fouché, op.cit.Plus tard, lorsque le front s'établit plus à l'est, une Ambulance américaine auxiliaire se constitua à Juilly, grâce à la générosité de Mme. H. Payne Whitney [de la famille Vanderbilt, future fondatrice du musée Whitney à New York].
La générosité d'une autre amie américaine rendit possible la création d'une deuxième ambulance américaine dans le collège de Juilly. Situé à une quarantaine de kilomètres à l'est de Paris, il fut doté du système de chauffage à la vapeur, d'un éclairage électrique et d'une plomberie ; c'était désormais un hôpital apte à recevoir deux cent blessés supplémentaires.
A. Piatt Andrew, With the American Ambulance Field Service in France, tirage privé, 1916, p. x
C'est alors que le service de transport de l'Ambulance se divisa en deux sections : le groupe "à la campagne", dépendant de l'Ambulance de Juilly et la flottille parisienne qui accueillait les patients arrivant par trains-ambulances à la gare de la Chapelle, et qui les emmenait ensuite aux divers ambulances et hôpitaux de la région parisienne.
La section Whitney, à Juilly, marche très bien et joue un rôle important dans le développement et l'extension de notre institution, comme Herrick le projetait et l'espérait dès l'origine ; et maintenant la section des voitures de transport, les groupes et division de "Ford", vont jouer un rôle plus considérable. Dernièrement ç'a été ma principale occupation et nous commençons tout juste. J'ai été enchanté aujourd'hui de recevoir un télégramme d'Elliot, disant qu'il y a de l'argent pour dix "Ford" supplémentaires. Nous pouvons en employer autant que nous en aurons, en ce moment, si nous réussissons à trouver des chauffeurs volontaires comme il nous en faut ; mais cela peut changer en une minute, comme tout le reste.
Robert Bacon, lettre du 17 décembre 1914, citée dans James Brown Scott, Robert Bacon, sa vie et ses lettres (1860-1919), Champion, Paris 1925, p 242

Cependant que l'infrastructure de l'Ambulance américaine se développait, une vaste campagne de recherche de support matériel et financier pour la France était menée aux Etats-Unis et gérée en France par des membres influents de la colonie américaine de Paris : le Comité de secours américain (American Relief Clearing House). Les amis de l'American Ambulance Field Service, souvent associés à cette campagne, étaient nombreux, à commencer par les ambassadeurs américains et leurs femmes - les Bacon, les Herrick et les Sharp - et par l'ambassadeur français à Washington, Jules Jusserand (dont la femme était américaine). Y figuraient également des banquiers comme Herman Harjes et des hommes d'affaires comme James Hazen Hyde et Whitney Warren. (Beaucoup d'entre eux étaient membres du Comité France-Amérique, fondé en 1909 pour la promotion de contacts entre les élites des deux pays).
Entre septembre 1914 et avril 1915, la gestion des deux services de transport de l'Ambulance américaine dépendait de l'autorité du Comité de l'Ambulance, émanation du Conseil d'Administration de l'Hôpital américain. A cette époque, le président de ce comité, Robert Bacon, prit brièvement le volant d'une voiture-ambulance.
Mr Bacon oublie --- ce qui est bien de lui --- de raconter dans sa lettre qu'il envoya plusieurs automobiles sur le champ de bataille, pour en ramener les blessés, et qu'il conduisit l'une d'elles. Les renseignements qui nous manquent nous sont fournis par le directeur de l'hôtel Crillon, où Mr Bacon descendait quand il était à Paris : "Personnellement et à ses frais, il avait réussi à assurer trois automobiles et, jour et nuit, sans cesse, il faisait le trajet entre Paris et le front, qui était à ce moment-là à Meaux et à Soissons, pour en rapporter les blessés."
James Brown Scott, Robert Bacon, sa vie et ses lettres (1860-1919), Champion, Paris 1925
Bacon avait été ambassadeur des Etats-Unis en France de 1909 à 1912, date à laquelle il quitta ce poste pour assumer des fonctions au sein du Conseil d'Administration de Harvard. Ce fut Bacon qui répondit à la demande d'un certain Abram Piatt Andrew, se portant volontaire pour le service en France.
"Qui sait ?" écrivit Piatt Andrew à Isabella Stewart Gardner d'un navire la nuit de Noël de 1914. "Il se peut que nous passions l'hiver à faire la navette de courses entre Paris et Neuilly." Andrew s'était porté volontaire pour conduire une ambulance pour l'Hôpital américain de Paris, mais plus concrètement, ses perspectives étaient tout à fait incertaines.
Tandis qu'à l'automne, la bataille de la Marne s'enlisait, Piatt Andrew disputait difficilement sa première campagne électorale, cherchant à évincer un confrère républicain (neveu de "Mrs Jack"), Augustus Peabody Gardner, député du Conté d'Essex dans le Massachusetts. L'hydravion, qui fit sensation à l'époque, et qu'il utilisait pour parcourir le "littoral nord", de Swamscott à Newburyport, n'empêcha pas sa sévère défaite. Le 21 septembre 1914, lors des élections primaires, il était vaincu par la "machine Gardner". Et c'est ainsi que le célibataire de 41 ans, ex-secrétaire adjoint du Trésor, ex-directeur de la Monnaie des Etats-Unis et ex-professeur de sciences économiques à Harvard eut tout le loisir de fermer sa maison de Gloucester et de partir pour la guerre.
"Je compte sur vous," écrivit Andrew à Robert Bacon "pour me trouver du travail à l'Hôpital américain de Paris." Bacon, qui avait servi sous les ordres de Pierpont Morgan, Theodore Roosevelt et William Howard Taft dans plusieurs postes-clef, était président de l'Hôpital. Il était redevable à Andrew pour avoir employé son fils, Robert Low Bacon, comme adjoint personnel au Trésor sous le gouvernement de Taft. Mais il n'y avait aucun poste disponible dans l'état major de l'hôpital et Bacon ne pouvait proposer qu'un emploi dans le service automobile, comme conducteur volontaire.
Andrew Gray, Tous et Tout pour la France, AFS Archives, NY 1989, p. 1
Andrew, diplômé de Princeton et de Harvard, ayant fait des études
universitaires à l'étranger (Allemagne et France), ancien trésorier de
la Croix Rouge américaine et représentant de celle-ci à la conférence
internationale de 1912, allait donc prendre le volant d'une ambulance,
au début de l'année 1915.
Six semaines d'une vie d'ambulancier aux environs de Dunkerque, début 1915, initièrent Andrew à l'odeur de la cordite, ainsi qu'à une connaissance pratique des problèmes de l'entretien des véhicules, de l'acquisition des pièces de rechange, et de la configuration des ambulances (celui de la Ford modèle T modifiée s'avérant de loin le plus apte). Mais on voulait lui confier un poste plus important.. Le comité de transport continuait à gérer le service sans le diriger, impuissant face à l'obstacle majeur à l'expansion du service : l'interdiction de la présence de volontaires près des lignes de front.
[...]
De retour à Neuilly en mars 1915, Andrew fit à Bacon une proposition de la plus haute importance. Il pourrait lui-même surmonter cet obstacle, pourvu que Bacon le soutienne face à toute objection éventuelle de la part du Comité de transport ou des médecins. Bacon se montra à la hauteur de la proposition, créant un nouveau poste à l'Ambulance, doté d'un titre grandiloquent. Dorénavant, Andrew serait Inspecteur général de l'American Ambulance Field Service, le terme field service servant à créer une distinction subtile entre les activités de ce dernier et celles de l'hôpital propre - terme qui survit jusqu'à nos jours dans le sigle par lequel un des principaux organismes d'échanges internationaux reconnaît ses origines martiales.
Andrew Gray, "The Birth of the American Field Service", dans Laurels, vol 59, n°1, édité par l'American Society of the French Legion of Honor, New York, 1988, pp 12-14.
Avril 1915 : Abram Piatt Andrew passant aux actes, c'est le début officiel de ce qui allait devenir l'AFS.
Lorsque "Doc" Andrew arriva en France, il constata que l'Hôpital américain disposait d'un groupe d'ambulances prêtes à effectuer des évacuations et de quelques voitures affectées à l'arrière-front belge. Les Français n'avaient pas imaginé que l'on pouvait laisser des ressortissants neutres s'approcher trop près du front. Andrew, par contre, envisageait ce que personne ne pouvait alors concevoir : des volontaires américains partageraient avec les combattants les rigueurs et les dangers de la vie du front. Il savait qu'une telle expérience commune forgerait un lien puissant entre les Etats-Unis et la France. Fort de son idée, il ne se laissa pas décourager et parvint jusqu'au Quartier Général de l'Armée où il avait un ami, Gabriel Puaux. Il lui exposa son idée, mettant l'accent sur l'effet positif que produirait une présence américaine sur le moral des troupes au front. Finalement, il reçut l'autorisation de se présenter au commandant de Montravel, affecté alors à l'Est. Encore une fois, Andrew dut se servir de la puissance de son raisonnement : il ne s'agissait pas uniquement d'envoyer quelques hommes de plus au front, mais plutôt d'attirer de plus en plus de jeunes Américains en France. Andrew réussit à convaincre le commandant ; c'est ainsi que le Service aux Armées de l'Ambulance américaine vit le jour.
Le principe de ce service était défini. Il fallait maintenant trouver les moyens nécessaires pour le concrétiser. Au début de 1915, Andrew s'y attaqua à sa façon, directe : il prit le paquebot, traversa l'Atlantique et rendit visite à un ami déjà bien disposé, Harry Sleeper. Andrew lui communiqua si bien sa vision de ce que les Etats-Unis pourraient accomplir que Harry allait consacrer tout son temps dans les années suivantes, à la création d'un magnifique service de recrutement et de recherche de fonds.
Jour et nuit pendant trois ans, Andrew ne négligeait aucun détail : construction et amélioration des ambulances, acheminement des provisions de qualité pour les hommes et les voitures, relations avec l'Armée française et ses officiers au front et à l'arrière, règlement des difficultés dues au renouvellement incessant des volontaires, contact continuel et obligatoire avec les Etats-Unis. Rien ne lui semblait trop insignifiant. Pour lui, tout projet, même le plus ambitieux, était digne d'être envisagé et mis en oeuvre. J'aurais aimé qu'il vous soit donné de le voir comme j'ai pu le faire à cette époque, alors que vous étiez au front. Mais n'est-ce pas sa vitalité, son imagination et la force de sa volonté qui vous ont permis d'y arriver, qui continuaient à s'occuper de vous pendant que vous y étiez et si souvent vous dirigeaient vers l'unité militaire la plus appropriée ?
Parallèlement, l'AFS ne cessait de croître : le nombre de volontaires en service atteignit les 3000, approvisionnés par un service efficace. Formidable entreprise, si l'on pense qu'hommes, provisions et fonds des quatre coins des Etats-Unis traversaient l'océan jusqu'en France où les sections d'ambulanciers s'éparpillaient le long du front... le tout conçu et coordonné par "Doc" Andrew.
Stephen Galatti, cité dans Rock, op.cit., pp 22-23
Les ambulanciers seraient désormais organisés en sections de 20 à 30 hommes, affectées à des unités de combat françaises et envoyées directement sur le front. Néanmoins, pendant encore un an, l'AAFS allait continuer de veiller sur ses opérations à partir d'un petit local dans l'enceinte de l'Ambulance, rue d'Inkermann à Neuilly.

En décembre 1915, Andrew fit venir un ambulancier de la section en campagne en Alsace : Stephen Galatti, lui aussi ancien de Harvard. Galatti allait devenir son "bras droit".
Ce printemps-là, tout le monde travaillait plus dur que jamais, mais Galatti en faisait à lui seul autant que nous tous réunis. Il ne prit jamais un jour de repos. Sept jours sur sept, il arrivait au bureau à 8 heures au plus tard. Il quittait le bureau parfois à 19 heures, parfois plus tard. Et quelles journées de travail ! Il téléphonait à l'agent de Bordeaux, choisissait la personne qu'il fallait pour un poste vacant, envoyait des "câbles" pour rassurer des parents, inquiets sans nouvelles de leur fils, retrouvait des livrets égarés, dictait des lettres, commandait des plaques en bronze portant les noms des donateurs et veillait à ce qu'elles soient installées sur la bonne ambulance... Il prêtait son oreille à la grogne, organisait de nouvelles sections et si, à 17 heures, comme ce fut souvent le cas, on recevait un télégramme annonçant l'arrivée imminente de 50 hommes sur le train de Bordeaux de 19h30, qu'importe, cela faisait partie du boulot. Il en faisait encore un peu plus que d'habitude et, à 19h30, il avait rassemblé assez de voitures à la gare d'Orsay pour transporter hommes et bagages... un repas et des lits les attendaient. Et, si le lendemain matin à 6 heures un convoi devait se rassembler, il était sur les lieux pour le voir partir.
John R. Fisher, "Rue Raynouard", American Field Service Bulletin, avril 1919

Au cours de l'été 1916, le Field Service souligna son indépendance
vis-à-vis de l'Ambulance américaine en supprimant le mot
ambulance de son nom. Avec la bénédiction de Robert Bacon et de
Madame Vanderbilt, l'AFS quitta donc l'Ambulance de Neuilly pour
s'installer dans la magnifique propriété de la comtesse de la
Villestreux (famille Hottinguer) au 21, rue Raynouard à Passy. C'était
un lieu historique dont les célèbres "eaux" avait attiré des hommes
illustres : Rousseau (censé y avoir composé Le devin du village),
Franklin (qui y aurait fait ses premières expériences sur le
paratonnerre) et Bartholdi, sculpteur de La Liberté éclairant le monde.
Le "21 Rue Raynouard" (ou "21" tout court) devint le home de l'AFS à
Paris, un lieu d'accueil et d'orientation analogue à ce que
deviendrait, beaucoup plus tard, le campus de CW Post aux Etats-Unis.
Le lendemain de mon baccalauréat, mon père me mena rue Raynouard jusqu'à une charmante maison Directoire qui n'existe plus et dont les jardins dévalaient vers la Seine. De grands arbres se penchaient sur de longues allées sinueuses qui enlaçaient comme des bras de vastes pelouses où il eût été délicieux de s'asseoir vers la fin d'un beau jour. Tout parlait de temps plus heureux que le nôtre. J'étais sensible à la mélancolie de ce lieu dont on chercherait vainement les traces dans le Paris actuel. Au bas des jardins, rangées en ordre devant la grille qui s'ouvrait sur le quai de Passy, je vis une vingtaine de voitures d'ambulance peintes en gris fer et ornées d'une croix rouge. La dernière de ces voitures était la mienne.
Julien Green, Partir avant le jour, Oeuvres complètes, Pléiade 1977, vol V, p 873
En avril 1917, les Etats-Unis prirent enfin officiellement part à la guerre.
Au moment où l'Amérique se range aux côtés des Alliés, un hommage particulier doit être rendu à ceux de ses fils qui, depuis deux ans et demi, partagent les dangers et la gloire de nos troupes. Parmi eux, les ambulanciers volontaires de l'American Ambulance Field Service méritent une mention reconnaissante. Venus de plus de quatre-vingt Universités américaines (Harvard, 159 volontaires; Princeton, 53; Yale, 47; Leland Stanford, 20; Wisconsin, 17; Pennsylvania, 16; Dartmouth, 16; Columbia, 15; Chicago, 12, etc.), ces jeunes hommes conduisent plusieurs centaines de voitures réparties en quatorze sections attachées à autant de divisions françaises. Quatre-vingt d'entre eux ont déjà reçu la médaille militaire ou la croix de guerre, et nombreux sont ceux qui sont tombés au champ d'honneur. Ce service, entièrement soutenu par la charité américaine à laquelle il a coûté plusieurs millions, est dirigé par M. A. Piatt Andrew, professeur à Harvard, ancien sous-secrétaire d'Etat au Trésor, et M. Stephen Galatti.
L'Illustration, n° 3867, le 14 avril 1917

Dès l'entrée en guerre des Etats-Unis, le service de transport de l'armée française fit appel à l'AFS pour fournir du personnel à son transport non-médical. A partir d'avril 1917 donc, certains volontaires AFS, au lieu de conduire des ambulances, allaient être affectés à la nouvelle Réserve Mallet dont la tâche était d'acheminer matériel et personnel militaires au front. Ensuite, au cours de l'été 1917, l'AFS passa officiellement sous l'administration militaire américaine.
Mais qu'allait devenir l'American Field Service quand le corps expéditionnaire américain atteindrait les côtes françaises ? Pourrait-il raisonnablement rester une organisation indépendante ?
Andrew joua immédiatement les plus gros enjeux, proposant d'utiliser le Service de campagne comme l'une des pierres angulaires du service sanitaire et par la suite de le maintenir comme une unité autonome dans l'organigramme de l'Armée américaine. Si Charles Evans Hughes avait été élu président en 1916 et si le général Leonard Wood avait repris son poste comme chef de l'état-major des armées, la proposition d'Andrew aurait fort bien pu aboutir, car les autorités françaises ne gardaient pas secrète leur préférence pour le renforcement immédiat de l'organisation déjà en service. En fait quand le maréchal Joffre se rendit en Amérique avec la commission de guerre française, début mai, il paya un tribut exceptionnel à ce petit groupe de conducteurs volontaires, en demandant aux Etats-Unis de prendre en charge le transport de tous les blessés français. Mais comme Leonard Wood très proche de Theodore Roosevelt , était persona non grata auprès du président Wilson, Andrew fut exclu des tractations de commandement dès le début. Ni le général Pershing, ni le Médecin Inspecteur général Corgas n'étaient intéressés par l'American Field Service. Des postes de commandement dans l'AFS, assuraient-ils, seraient donnés uniquement à des soldats de métier et non à des outsiders comme Andrew. C'est ainsi que l'Armée des Etats-Unis mit sur pied son propre service sanitaire. Il était calqué sur le modèle du Field Service, mais dix fois plus important en hommes et en ressources.
Andrew Gray, Origins of the American Field Service , pp 13-14
 |
 |  |
Vous venez d'adhérer à l'American Field Service. Vos efforts démesurés pour obtenir un certificat de naissance juste pour apprendre que vous n'êtes jamais né officiellement, votre visite précipitée chez le photographe, vos démarches auprès du consulat français, au bureau des passeports, à l'agence de la compagnie maritime, vos adieux attristés aux amis et à la famille, tout cela est fini. Vous êtes à bord, enfin en route pour la France. Vous souvenez-vous de l'excitation provoquée par cette constatation ? La semaine de vie à bord qui suit est monotone, animée seulement par quelques exercices de sauvetage. Et puis un matin, quelques marins en uniforme français apparaissent sur le pont et l'on ôte la bâche qui couvre le canon à l'arrière. Ils en nettoient le baril et font quelques essais de tir. L'officier de marine, qui auparavant passait son temps à jouer au bridge dans le salon, monte sur la passerelle et prend charge du vaisseau. Vous vivez ensuite deux jours et deux nuits d'émotions intenses, pendant que le bateau traverse la zone des sous marins. Puis un beau matin, vous allez sur le pont et vous découvrez que vous êtes en train de remonter doucement la Gironde. Quelques heures après, vous débarquez à Bordeaux : c'est la France et vous avez achevé la première étape vers la vie du front, vers la guerre.
Vous souvenez-vous de votre passage dans Bordeaux et la magnifique région viticole ? Le "jardin de la France" tourangeau ? Les paysages qui se déroulaient devant vos yeux jusqu'à Paris ? Là, un homme en uniforme kaki vous attend à la gare, un homme qui paraît extrêmement efficace et qui connaît tous les recoins de cette gare si mal éclairée. Il récupère vos bagages et les installe à côté de vous à l'arrière d'une ambulance, avant de partir à grande vitesse, fonçant à travers d'innombrables petites rues, accélérant dans les virages : une course interminable qui va pourtant aboutir dans la cour du 21, rue Raynouard. Vous ne dormez pas bien cette nuit : tout s'est passé tellement vite que vous n'avez pas eu le temps de réfléchir. Vous resterez éveillé longtemps à passer en revue toutes les impressions de la journée.
Le lendemain matin, vous rencontrez les hommes qui vont veiller sur votre destin pendant les six mois à venir. "Doc" vous reçoit chaleureusement, vous exprimant combien il est heureux de vous accueillir à l'AFS. Il vous prévient contre les... comment dire, "dangers" de Paris. Puis il vous fait sentir que vous êtes précisément la personne, parmi tous les Américains des Etats-Unis, qu'il avait souhaitée voir se joindre à l'AFS. Ensuite, il vous confie à "Steve". Celui-ci est l'adjoint qui, comme vous le comprendrez rapidement, partage le sort de tout adjoint, puisqu'il est censé tout savoir et tout faire à l'AFS. Il est tellement occupé que vous vous demandez quand et comment il trouve le temps de manger et de dormir.
J.R. Greenwood, dans History of the American Field Service in France, Houghton Mifflin, Boston 1920, vol II, pp 490-1.
 |
 |
 |
Si la nature du Field Service devait ses origines à la première Ambulance américaine --- service international de secours aux blessés de guerre --- son esprit serait fortement marqué par ceux qui allaient prendre le volant des voitures-ambulance : de jeunes universitaires américains d'un milieu plutôt privilégié, puisqu'il fallait déjà pouvoir payer le voyage transatlantique. Ces aventuriers, inspirés par les mythes romantiques de preux chevaliers et vaillants croisés, venaient en Europe pour sauver la Civilisation des mains des "Huns".
La jeune Amérique était grisée par les triomphes faciles de la guerre
hispano-américaine de 1898 ; les Indiens avaient depuis longtemps été
refoulés et la Nouvelle Frontière ne se trouvait plus à l'Ouest mais à
l'Est, le long des tranchées de la Grande Guerre. Ces jeunes
gens partaient donc sur les champs de bataille, nourris de grandes
idées et de sentiments nobles.
L'ambulancier américain est un type qui vient en France pour sauver l'Humanité. Deux semaines au front et il a compris qu'il s'agit de sa propre peau. Du Vermont à Verdun, il a fait du chemin. Son initiation militaire débute par l'apprentissage de la Marseillaise et de l'expression Vive la France et se complète par la maîtrise des formules après vous et où est l'abri ?
Il arrive dans un élan d'enthousiasme généreux, prêt à tout pour défendre le bien-être de ses semblables. Puis, tout doucement, il se ravise, sans perdre son enthousiasme, pour adopter un farouche individualisme.
A Paris, il ne pensait qu'au front. Au front, il ne rêve que d'une permission. Son énergie et son ambition se transforment en indifférence passive dès le deuxième pneu crevé. Et s'il était assez présentable avant, il perd rapidement le goût de tout, sauf de l'alcool et du tabac. Il fuit le bain comme la peste et se prend d'affection pour ses camarades inséparables, les puces et les rats.
Ceci dit, il ne manque pas d'acquérir des connaissances utiles. Il en sait plus sur les abris que ceux qui les ont construits. Il est expert en départs et arrivées. Et aucun psychologue n'a mené autant d'expériences sur la nature de l'instinct de survie.
Voilà pour notre pauvre ambulancier. Il a échangé ses beaux rêves contre des axiomes matérialistes. Bref, il revient de son expérience complètement démoralisé, mais infiniment plus sage.
Auteur anonyme, dans l'AFS Bulletin, N¯ 17, 27 octobre 1917.
 |
 |
 |
La dure réalité de cette guerre devait marquer l'esprit de cette
génération d'idéalistes. Les premiers volontaires de l'AAFS
décrivirent leurs expériences afin d'influencer l'opinion publique
américaine en faveur de la cause des Français. Un film, Nos garçons
américains dans la guerre européenne, fut tourné dans ce sens en 1916.
De nombreux livres furent publiés, dont Amis de la France, un recueil de
lettres d'ambulanciers, préfacé par Andrew et traduit en français par
Firmin Roz, professeur à la Sorbonne et ancien maître de conférence à
Harvard.
Qui étaient ces ambulanciers ? Des jeunes idéalistes, des aventuriers, des intellectuels, des francophiles en tout cas.
Bon nombre des conducteurs de ces ambulances ont passé une partie de
leur vie d'étudiant en France et ont été ravi d'y retourner, par
gratitude, afin de faire tout leur possible pour un pays qui leur avait
laissé de si bons souvenirs ; ils sont architectes, artistes, avocats,
il y a même quelques pasteurs.
American Fund for French Wounded, Monthly Report, Paris, octobre 1916
Il n'est pas étonnant qu'un nombre considérable d'ambulanciers
volontaires de cette "génération perdue" se soit lancé dans la
littérature. Certains de ceux qui deviendraient des auteurs
célèbres, comme Malcom Cowley ou Louis Bromfield, servirent directement
dans des sections sanitaires françaises. D'autres, comme John Dos
Passos et E.E. Cummings firent partie du corps Norton-Harjes. Julien
Green, après cinq mois avec l'AFS en 1917, n'avait que 17 ans lorsque le
service fut rattaché à l'administration militaire américaine. Trop
jeune pour être officiellement "militaire", il se porta volontaire au
service ambulancier de la Croix-Rouge américaine en Italie, dans les
rangs duquel servait un certain Ernest Hemingway.
Quelqu'un était là. Devant moi, presque à mes pieds, un soldat étendu sur un brancard. Je m'arrêtai aussitôt. Sur la tête et la poitrine, on avait jeté sa capote qui laissait passer deux mains blanches et jeunes, sagement posées de chaque côté du corps. De même, les jambes et les pieds étaient joints bien droits. J'allai ranger ma voiture au fond de la grange et je revins auprès du soldat. Ce qui se passa en moi à cette minute, je ne pourrai jamais l'exprimer. De la tristesse mêlée à la fureur, de l'amour aussi, j'éprouvai tout cela d'un coup. Les mains étaient presque les mains de garçonnet avec des doigts déliés qui devaient bien mal tenir un fusil. Et sous la capote bleu horizon, qu'y avait-il ? Je ne voulais pas savoir, je regardai seulement ce corps un peu fluet, tranquille, entouré d'un silence extraordinaire et d'une solitude que ma présence ne troublait pas. Mon coeur se serra horriblement et je n'ai pas honte de dire que des larmes roulèrent sur mes joues, des larmes de compassion sans doute, mais qui ressemblaient bien à des larmes d'amour, et la haine de la guerre s'installa dans mon coeur à jamais. Je fis le voeu de ne jamais tuer, même pour me défendre, et pris Dieu à témoin de ce que je promettais.
Julien Green, Mille chemins ouverts, Oeuvres complètes, éditions Pléiade, vol V, pp 893-894
Les premières expériences "départ" du Field Service furent rudes pour
ces jeunes aventuriers. Parmi les 2569 ambulanciers américains,
127 ne reviendraient pas des champs de bataille, un petit nombre au vu
des 8 millions de morts de la Grande Guerre, mais 127 personnes de trop
pour la "famille" AFS.
Cela ne m'étonne pas que les Français aient tant tenu à ces jeunes chauffeurs qui, la tête haute, le sourire franc, la cigarette posée négligemment au coin de la bouche, traversaient l'Enfer sans aucun souci apparent. Ils ne le traversaient pas tous, d'ailleurs, car parfois les éclats d'un obus, dans une explosion rougeoyante, faisaient taire une de ces âmes courageuses. Des Vosges jusqu'aux plaines de Picardie en passant par Verdun, des monticules de terre surmontés de croix marquent les lieux où ces jeunes chercheurs de la Grande Aventure trouvèrent ce qu'ils avaient si souvent contemplé sans peur, avec leur regard si jeune et franc.
J.R. Church, The Doctor's Part, Appleton, New York, 1918, pp.186-187


Qu'allait devenir l'AFS après la guerre ? Etait-il possible qu'un tel
élan d'enthousiasme n'aboutisse qu'à une "cour vide" ?
|
Paris 26 Mai 1919 Cher Monsieur Andrew, Les portes du "21" sont fermées. La cour est vide. L'écriteau "Service Automobile Américain aux Armées Françaises" a disparu. Tout est mort et d'une grande tristesse. - Comme les jours mouvementés des temps de grande activité sont déjà loin! - Le Major Galatti nous a quittés la semaine dernière ; dans quelques jours, Monsieur Sleeper partira également et il ne restera ici que peu de survivants de l'AFS en France. Jeanne termine les écritures avec les experts et, sa tâche finie, elle partira à la campagne prendre un repos bien mérité. Moi, je dirige l'épave de l'A.F.S. au "20" et ferai l'impossible pour me montrer le digne représentant du Service à Paris. Je suis très bien installé et ai déjà reçu au Bureau la visite d'un certain nombre de jeunes désireux d'obtenir différents renseignements. Madame la Comtesse de la Villestreux nous a fait l'autre jour l'honneur de venir prendre une tasse de thé et a eu la délicate attention d'offrir à Jeanne et à moi un très joli petit souvenir, un presse papier en bronze représentant l'Alsace et la Lorraine avec au dos nos initiales et "Field Service 1915-1919." Mme la Comtesse a été navrée que vous soyez parti avant son retour et m'a dit qu'elle allait vous écrire pour vous gronder et aussi pour vous dire combien elle regrette votre départ à tous. J'espère que vous êtes arrivé à Gloucester à bon port et que malgré la joie de remettre le pied sur votre terre natale vous penserez encore de temps en temps au "doux pays de France." Ceci est simplement un petit mot personnel destiné à vous prouver que nous pensons aux absents et que nous aussi nous voyons avec regret la fin d'un Service qui a tant fait pour aider notre pays aux jours d'épreuves. Jeanne se joint à moi pour vous envoyer notre meilleur et plus respectueux souvenir. G. Bétourné P.S. Madame Grimbert téléphone à l'instant et me prie de vous transmettre ses meilleurs amitiés. |
Après l'armistice Andrew resta à Paris assez longtemps pour assister au congrès qui créa l'American Legion au Cirque d'Hiver en mars 1919 et examina comment son Service pourrait reprendre vie. Car il lui paraissait inconcevable qu'un dévouement aussi ardent à la cause de la France - Tous et tout pour la France ayant été la devise qu'il avait donnée à son Service - ne puisse trouver son incorporation dans une institution permanente.
Andrew Gray, Origines de l'American Field Service, p. 15
Dans le dernier numéro du bulletin de l'AFS, publié en avril 1919, A. Piatt Andrew fit la part des choses.
La partie visible et externe du vieux Service aux Armées a disparu à jamais. Aujourd'hui ce n'est que souvenir. Nos vieilles Ford ont regagné une dernière fois leurs postes, elles ont transporté leur dernier convoi de poilus blessés. [...] Mais le Field Service vit toujours et vivra aussi longtemps que l'on se souviendra de nous. Les années à venir nous donneront des occasions de perpétuer d'anciennes amitiés nouées pendant la guerre. [...] Essayons de faire de la camaraderie née des quatre dernières années, plus qu'une association d'anciens combattants d'une guerre révolue : une organisation vivante avec un idéal vital à atteindre. L'objectif principal que l'ancien Field Service tâchait de mettre en oeuvre était d'expliquer la France à l'Amérique et l'Amérique à la France, de faire connaître aux Etats-Unis ce qu'était et ce qu'est la France et d'aider d'autres Américains à sentir et à apprécier ce que nous avons senti et apprécié ces quatre dernières années. Cet effort ne doit pas s'arrêter avec la fin de la guerre. Nous sommes quatre ou cinq mille à nous être portés volontaires pour la France pendant la guerre et nous pouvons continuer à nous consacrer au même idéal pendant les années à venir.
Avec un réseau aussi bien établi en 'Amérique, nous ne devons pas nous limiter à l'établissement de clubs et à l'organisation de réunions pour perpétuer le souvenir du passé. Il y a beaucoup d'autres choses que nous pouvons effectuer dans l'avenir. Il a été suggéré que nous fassions venir de temps en temps aux Etats-Unis des représentants français en tant que conférenciers AFS : de ceux qui faisaient le discours, rue Raynouard, aux fêtes d'adieu aux sections. Vu l'importance de nos contacts, nous devrions pouvoir arranger des conférences dans toutes les grandes universités et dans toutes les grandes villes. On nous a également proposé d'établir, dans les universités et les régions d'où nous sommes issus, des bourses AFS pour des étudiants américains en France et pour des étudiants français en Amérique. Par de telles actions nous pourrions faire du vieux Field Service un élément actif et important dans la promotion des objectifs pour lesquels nous oeuvrions en France - un élément qui continuera de compter dans le monde longtemps après notre disparition.
A. Piatt Andrew, AFS Bulletin, numéro consacré à la rue Raynouard, avril 1919
En cherchant le moyen de continuer l'oeuvre des ambulanciers volontaires, Andrew avait dû discuter avec ses collègues une idée qui était alors "dans l'air", celle des bourses d'études universitaires. L'intérêt pour des Américains - comme ceux qui constituaient le gros du corps d'ambulanciers - de poursuivre leurs études en France avait évolué depuis l'époque où on ne connaissait à Paris qu'artistes et architectes américains en pèlerinage aux Beaux-Arts. Les autorités de la Sorbonne ayant eu le souci d'établir, bien avant la guerre, un doctorat d'université accessible aux étrangers, il était certainement temps de créer de telles bourses. Les ambulanciers de l'AFS, fraîchement sortis du milieu universitaire, ne purent qu'applaudir le principe soit d'offrir à leurs compatriotes l'opportunité de découvrir la France, soit de continuer leur propre parcours avec l'AFS grâce à une bourse.
Des membres de l'AFS tinrent maintes consultations pour savoir comment continuer l'oeuvre qu'ils avaient entreprise en 1914. Finalement, on décida - ce serait utile et durable - de créer des bourses d'études entre des universités françaises et américaines. Néanmoins, lorsqu'ils retournèrent aux Etats-Unis à l'été 1919, ils découvrirent qu'une association avait déjà été organisée autour du même objectif - les American Fellowships in French Universities, fondée et cautionnée par M. Myron T. Herrick. [...] Le début des American Fellowships in French Universities remontait à l'année 1915. Le docteur John H. Wigmore, doyen de droit à la Northeastern University de Chicago, avait reçu une lettre du professeur C.H. Grandgent, exchange professor à la Sorbonne, qui l'informait que le projet serait bien reçu par les autorités françaises. [...] M. Herrick, ayant appris que l'AFS était intéressé par un projet semblable, l'avisa qu'une alliance des deux associations serait possible. A l'assemblée constituante, M. Herrick et ses associés [...], par déférence à tout ce que l'AFS avait déjà accompli pour les relations franco-américaines, proposèrent de supprimer leur propre identité et de renommer l'association l'American Field Service Fellowships for French Universities.
George Rock, op.cit., pp 16-17
Ainsi, en 1919, avec les fonds qui leur restaient après la guerre, l'AFS créa la fondation qui allait alimenter les American Field Service Fellowships for French Universities, fondation qui s'inscrivait dans le contexte du vaste mouvement de solidarité franco-américaine créé par la guerre.
L'Office National des Universités et Ecoles Françaises est devenu incontestablement le centre des relations intellectuelles et scientifiques avec les Etats-Unis. [...] L'échange des étudiants lui a été entièrement confié. En 1918 et en 1919, une de ses occupations principales a été l'envoi de boursières et de boursiers français en Amérique. Dans un mouvement d'admirable générosité, l'Association des Collèges américains [...] a offert à nos étudiantes, à nos lycéennes, à nos institutrices, un grand nombre de bourses. [...] On ne s'est pas borné là, on nous a offert pendant l'hiver de 1918-1919 des bourses pour nos étudiants blessés de guerre ; l'Office des Universités en a envoyé trente-quatre. A la rentrée scolaire de 1919, vingt-neuf bourses ont été données à des étudiants français. Les unes sont dues à des Universités, à des Collèges et à des Instituts techniques ; les autres ont été fondées par l'Association des Etudiants américains accueillis dans les Universités françaises pendant la période de démobilisation.
[...]
Mélanger ainsi nos jeunes compatriotes à la jeunesse américaine, qui est d'éducation et de moeurs si différentes, était une opération assez délicate. On a pris des précautions, on a donné les conseils nécessaires ; tout s'est en somme très bien passé. Une belle oeuvre a été faite et va être continuée. Elle ne contribuera pas seulement à rapprocher deux jeunesses, à dissiper quantité de préjugés, à ouvrir des intelligences et à unir des coeurs [...]
Il n'eût été ni cordial, ni décent, de ne pas établir de contrepartie. L'Office des Universités a obtenu du Gouvernement français la création de bourses pour les étudiantes américaines. [...] On doit ajouter que la Society for American Fellowships in French Universities a envoyé à la rentrée d'octobre huit boursiers dans nos Universités.
Il faut signaler à part, comme un événement appartenant à l'histoire de la guerre, les études faites dans nos Universités, pendant la période de la démobilisation, de mars à juillet 1919, par 5.200 étudiants américains. Toulouse en a reçu 1.223, Paris 904, Montpellier 517, Grenoble 400, Bordeaux 397, etc...
Ch. Petit-Dutaillis, Relations universitaires de la France avec les Etats-Unis, Cerf, Paris 1919, pp1-2
Le financement d'études pour des Américains en France datait d'avant la guerre. Mais les French Fellowships de l'AFS proposaient quelque chose de nouveau : l'application du principe de l'échange de professeurs pour les étudiants et ce en souvenir d'autres jeunes étudiants...
Afin de perpétuer la mémoire des cent vingt-sept hommes de l'AFS qui ont sacrifié leur vie pour la Cause et afin que des générations futures de jeunes Français et Américains puissent retrouver la compréhension mutuelle et la fraternité d'esprit qui avaient marqué les relations entre leurs aînés pendant la guerre, nous créons une association, AFS Fellowships for French Universities. Cette association propose des bourses en France, à des étudiants sélectionnés dans les universités ou dans des grandes écoles d'ingénieur américaines. Elle propose également des bourses pour des étudiants français dans des universités américaines. Chaque bourse, une fois établie, portera le nom d'un des hommes de l'AFS mort en France. Nous souhaitons rassembler assez de fonds pour pouvoir établir une bourse à la mémoire de chacun de ces hommes.
Marque-page AFS de l'époque, Archives de l'AFS à New York
Le président d'honneur des French Fellowships était l'ambassadeur Jusserand et le directeur d'honneur, l'ambassadeur Herrick. Aussitôt établis, les American Field Service Fellowships commencèrent à attribuer des bourses, la première vague de boursiers reflétant les priorités de Wigmore et Grandgent, auteurs en 1917 de Science and Learning in France : 5 sur 8 poursuivraient des études de science, de psychologie ou de sociologie. Piatt Andrew, pourtant, avait une autre idée en tête. Il voulait que le mouvement allât dans les deux sens - que des Français eussent également l'opportunité de bénéficier de bourses à l'étranger La promotion de l'année suivante témoignerait de son influence : il y aurait un Français parmi les 23 boursiers de 1920 dont 6, d'ailleurs, seraient des anciens ambulanciers de l'AFS.
Les Fellowships furent une entreprise pionnière, comme l'avaient été les sections d'ambulances et de camions. Pendant la guerre, il n'y eut aucun autre cas d'ambulances légères si près du front et dont les chauffeurs étaient originaires de pays neutres. En 1920, les seuls autres échanges scolaires organisés étaient ceux financés depuis 1903 par la Fondation Rhodes et depuis 1911 par la Fondation scandinavo-américaine. Dans les deux cas, la portée, le but et le financement étaient différents de ceux des Fellowships de l'AFS. Avant la guerre, les étudiants individuels se dirigeaient plutôt vers l'Allemagne, dont la tradition scolaire avait tellement influencé le système développé aux Etats-Unis. Les French Fellowships représentaient donc "un moyen de perpétuer l'esprit du bon vieux temps dans l'avenir" écrivait Stephen Galatti en 1922.
G. Rock, op.cit., p. 18
 |
 |
 |
Né de la guerre, l'AFS avait d'abord évolué dans le cadre de l'Ambulance américaine et ensuite dans celui de l'administration militaire des armées française et américaine. En 1919, la mise en place des Bourses françaises avait représenté un premier pas en temps de paix. Maintenant, il fallait définir la forme sous laquelle l'AFS lui-même se développerait.
Du 7 au 9 mai 1920, une réunion d'environ 600 membres de l'AFS eut lieu à New York afin d'organiser l'Association de l'AFS, d'adopter un règlement intérieur et d'élire les responsables du conseil d'administration. Les objectifs de l'Association sont définis par le règlement intérieur de la façon suivante :
"Le but de cette Association est, sur le plan général, de perpétuer le souvenir de notre vie et de notre travail de volontaires au service de l'Armée française pendant la période 1915-1917, d'entretenir les amitiés créées à cette époque et de promouvoir à l'avenir une compréhension mutuelle et des sentiments de fraternité entre la France et les Etats-Unis. Ce but sera, sur le plan particulier, de tenir des réunions, de publier et diffuser le bulletin de l'Association, de coopérer avec tous les membres du conseil d'administration des Bourses françaises, de fournir, par l'intermédiaire d'un comité en France, des renseignements et de l'aide aux membres de l'Association ainsi qu'aux Boursiers AFS lorsqu'ils sont en France et, chaque fois que l'occasion se présentera, d'organiser des conférences pour les Français en visite aux Etats-Unis et les accueillir."
cité dans History of the AFS, 1920; vol III, pp 573-574
 Pierre Lepaulle |
" Maurice Pérouse |
 Raymond Samuel |
L'idée de bourses dans les deux sens se heurta aux conditions économiques des années 20, comme en témoigne cet extrait d'une lettre que Pierre Le Paulle, premier boursier français, écrivit à Andrew, en mai 1920 : "Avec la dépréciation du change, ma bourse, payée en francs ne m'a permis que de vivre très modestement et me laisse incapable de payer mon passage." En dépit du geste de Georges Clemenceau, qui consacra la totalité des recettes de ses conférences américaines aux Fellowships, le "pouvoir d'achat" des fonds ne cessa de se dévaloriser. En plus, la vision proprement "AFS" manqua à la fondation qui portait son nom. Andrew, s'étant de nouveau lancé dans la politique à Washington, avait d'autres soucis. Galatti, ayant repris sa carrière de courtier à la Bourse de New York, allait fonder une famille. Sans l'attention de ces deux "locomotives", l'enthousiasme initial pour les "échanges" s'estompa. De 30 boursiers par an (en comptant ceux qui bénéficiaient d'un financement de deux ans) de 1920 et 1921, on passa à 16 en 1922, puis 13 en 1923 - uniquement des Américains étudiant en France.
En 1924, l'administration du programme d'échanges universitaires fut donc confiée à l'Institute of International Education à New York, grâce à la générosité de James Hazen Hyde, vieil ami de l'AFS et fondateur du premier échange de professeurs entre Harvard et la Sorbonne.
L'Institute of International Education a été organisé le 1er février 1919 à la suite de projets formulés par son directeur, le professeur Stephen Duggan qui, avant la guerre, avait mis l'accent sur la grande nécessité de créer aux Etats-Unis un organisme capable de cultiver, chez les Américains, une meilleure compréhension des problèmes et difficultés d'autres peuples. [...] Les échanges d'étudiants, créés par l'Institut, entre des colleges et universités américains d'une part et des universités étrangères de l'autre, connaissent un développement remarquable. Depuis 1920, où il joue un rôle important dans l'accueil d'étudiants français aux Etats-Unis, l'Institut prend une part active dans la création d'échanges de bourses universitaires. N'ayant pas ses propres fonds, il prévoit un programme qui permettrait à des jeunes américains d'aller étudier dans des universités à l'étranger, en échange de quoi des étudiants étrangers pourraient venir aux Etats-Unis. [...] Grâce à l'excellente gestion des bourses d'échange développée par l'Institut, certaines autres associations lui ont confié l'administration de leurs bourses. Parmi ces associations se trouvent : les American Field Service Fellowships for French Universities, Inc ; la Germanistic Society of America, Inc ; Scholarships for the Junior Year Abroad (en France et en Allemagne) ; Carnegie Art Scholarships (pour l'été).
Institute of International Education, Its Organization, Aims and Activities, Bulletin N¯ 2, 1936
En l'absence de direction inspirée - à part la priorité donnée aux
anciens ambulanciers - l'Institute of International Education gère les
AFS Fellowships professionnellement, sans plus. De 1924 à 1932, 10
bourses en moyenne par an seront attribuées ; 5 de 1932 à 1939.
Qui postulait pour ces bourses ? Ce furent essentiellement de jeunes
universitaires américains, semblables à ceux qui avaient conduit des
ambulances pendant la guerre : 168 en tout entre 1919 et 1943. Les 21
des quelques 2000 ambulanciers de l'AFS qui réussirent à obtenir une
bourse vinaient tous de la promotion de 1917 ; un tiers de ceux-ci ne
représentant qu'une seule unité : la TMU-133 composée d'étudiants de
l'université de Californie.
Dans les années 30 --- conséquence de la dépression économique --- la
fondation des Fellowships n'accordait que 5 bourses par an - une réalité
bien loin de l'ambition des ambulanciers de 1919 "de créer 127 bourses
en honneur de nos camarades disparus". En 1935, Andrew revint à la
fondation pour faire un dernier geste. Il exigea que des Français
pussent de nouveau bénéficier de bourses. Hélas, il ne vivrait pas assez
longtemps pour voir arriver Maurice Pérouse à Boston en septembre 1936.
à bord du paquebot Lafayette, le 9.8.1937
"Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage,
Et puis est retourné, plein d'usage et de raison,
Vivre entre ses parents le reste de son âge."Je suis bientôt "entre mes parents", rentrant en France sur le paquebot français Lafayette, et je pense à la merveilleuse année qui je viens de passer en Amérique grâce à la générosité de l'American Field Service. Une telle année est peut-être la plus intéressante qu'un jeune homme puisse vivre après avoir terminé ses études en Europe. Les principes d'éducation sont entièrement différents dans les deux pays et il est très utile d'être guidé successivement par les deux systèmes. [...] Mais la connaissance technique n'est pas la seule à être améliorée par une telle expérience. La connaissance d'un pays, de son peuple, de sa culture et de sa langue a toujours été considérée à juste titre comme le meilleur moyen d'enrichir son esprit, se donner "usage et raison."
Maurice J. Pérouse, extraits d'une lettre citée dans le Bulletin of the American Field Service, juin 1939, p 34
Andrew avait remis les "échanges" de l'AFS sur les rails. Pour les années 1936, 1937, 1938, il y aurait toujours un boursier français. 1939, la guerre ouvra une parenthèse : un seul boursier (américain), aucun en 1940... ce qui permettrait à la fondation d'accorder 4 bourses pour l'année 1941 : toutes les quatre allouées à des Français. Ainsi, de 1919 à 1943, avant que la Seconde Guerre mondiale n'ouvrât une parenthèse aux échanges, parmi les 168 bénéficiaires des French Fellowships, on dénombrait 7 Français :
| 1920-22 |
LE PAULLE, Pierre G. | Paris | Harvard Law School |
| 1936-37 |
PEROUSE, Maurice J | Lyon | MIT |
| 1937-38 |
SAMUEL, Raymond | Dijon | MIT |
| 1938-40 |
GUEIROARD, Robert | U.S.A. | Harvard Business School |
| BARRET, Maurice | Paris | Harvard Graduate School | |
| FOY, Louis-André | Bourg-la-Reine | Berkeley, Poli. Sci. | |
| MOREAU DE BONREPOS, Ludovic | Paris | Harvard Business School |
Ce premier programme d'échanges de l'AFS, qui reprendrait après la guerre, ressemblait à l'expérience des ambulanciers dans son aspect découverte et appréciation d'une autre culture.
J'estime que le plus grand avantage que j'ai tiré de mes deux années d'études en France, c'est l'acquisition d'un point de vue international. Je me suis fait de nombreux amis français, dont certains sont devenus des amis très proches. J'ai aussi côtoyé au moins une quinzaine de personnes de nationalités différentes. Rencontrer des gens d'une telle diversité d'origine a été d'une valeur inestimable. J'ai surtout gagné une meilleure compréhension des problèmes de mon propre pays, en les considérant avec une autre perspective et à la lumière de ces nouvelles idées.
cité dans George Rock, op. cit., p. 20
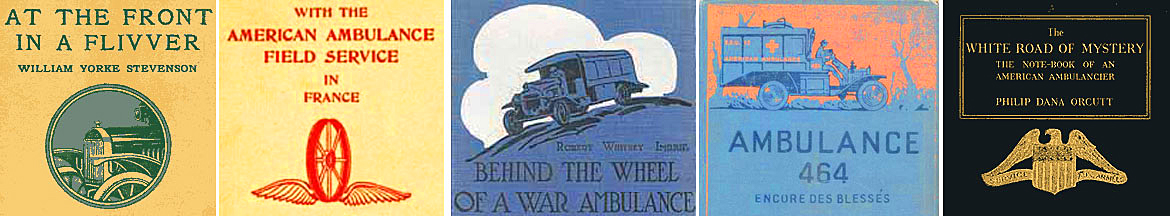
Après la guerre, l'Association publia plusieurs livres commémoratifs. Le premier, en trois volumes, décrivait en détail l'organisation, l'aménagement, les personnalités et les activités du service et comprenait une série de chapitres relatant l'histoire de chaque section sanitaire. Le maréchal Joffre écrivit la lettre de frontispice.
Un deuxième ouvrage, le livre d'or, était consacré aux disparus.
Comment mieux célébrer ces hommes que d'encourager ,dans l'avenir, l'amitié et la compréhension entre la jeunesse des deux pays [...] Des générations successives de jeunes Français et Américains voyageront désormais entre les deux pays, promouvant compréhension et sympathie mutuelles, ainsi que ces hommes se plaisaient à le faire.
JWD Seymour, Memorial Volume of the AFS in France, AFS 1921, p. xi
Par ailleurs, les ambulanciers allaient raconter leurs expériences. Une bibliographie assez complète se trouve en annexe du volume III, pp 552-558, de l'History of the American Field Service in France. En plus des vingt-cinq livres cités, d'autres descriptions célèbres de la vie d'ambulancier devaient paraître plus tard : My Green Years de Louis Bromfield, L'énorme chambrée d'E.E. Cummings, Les jeunes années de John Dos Passos, Le soleil se lève aussi d'Ernest Hemingway, La guerre vue d'une ambulance de l'abbé Félix Klein...
A l'occasion de la grande réunion des anciens ambulanciers à New York, le 9 mai 1920, l'AFS reçut de nombreux messages de félicitations.
Paris, le 5 mai 1920
J'apprends avec émotion l'initiative si noble prise par l'American Field Service. Après avoir, dès les premières heures de la tempête universelle, affronté à dix mille kilomètres de la patrie, tous les combats, les survivants veulent encore fournir l'exemple, et joindre la générosité à la vaillance. Ils seront les bienvenus parmi nous - les jeunes héros que vous nous enverrez. Nous entourerons leur âme, à la fois délicate et fière, de toute la sollicitude fraternelle dont déborde notre coeur. Et la grande France, victorieuse et meurtrie, cette France qui garde dans sa terre bouleversée les corps des héros disparus, se fera douce et tendre aux jeunes hommes qui viendront goûter sa culture, apprendre sa langue, ses usages, son esprit, et sa conscience.
René Viviani, cité dans History of the American Field Service in France, vol III, pp. 576-577
J'ai été personnellement témoin des magnifiques résultats obtenus par l'American Field Service, et du splendide courage déployé sur les champs de bataille de France par des volontaires des Etats-Unis avant même l'entrée de leur pays dans la guerre Américaine. Tous les Français demeurent très reconnaissants à l'American Field Service, et tous seront heureux d'accueillir les jeunes Américains qui viendront recevoir dans nos établissements universitaires une partie de leur éducation.
Raymond Poincaré, ibid., p. 577
J'ai connu l'appui précieux que les volontaires de l'American Field Service engagés sur notre front avant l'entrée en guerre des Etats Unis, ont fourni à la cause de mon pays, et j'accueille avec plaisir le nouveau témoignage de leur sympathie manifesté par l'envoi en France des jeunes Américains afin de leur permettre d'achever leur éducation dans nos universités. Cette initiative est sûrement destinée à sceller pour toujours l'amitié de nos deux pays.
George Clemenceau, ibid. , pp. 577-578

Dans son bulletin de mars 1935, l'Association annonça son intention d'aménager un dépôt permanent pour ses trophées et ses archives dans "une salle du musée de la Coopération Franco-Américaine de Blérancourt, situé à une centaine de kilomètres au nord-est de Paris dans une région qui avait été sur la ligne de front pendant la guerre."
Il n'existe aucun lieu approprié ou satisfaisant dans notre propre pays. En France, il y en a plusieurs. Le colonel Andrew et le major Galatti ont récemment discuté avec Mme William K. Vanderbilt et Mlle Anne Morgan de la possibilité d'acquérir une salle d'exposition dans le musée franco-américain qu'elles avaient organisé à Blérancourt et qu'elles avaient offert au gouvernement français. Fidèles amies du Field Service, elles seraient ravies de nous y accueillir.
George Rock, op.cit., p. 21
Madame Vanderbilt était la marraine de l'AFS depuis ses débuts.
Miss Morgan, membre du conseil d'administration du Comité américain pour les blessés français, connaissait le Field Service depuis 1916.L'existence du musée du Field Service à Blérancourt est due principalement aux interventions de Miss Ann Morgan et de Mme William K Vanderbilt. C'était aussi grâce à cette dernière que le Field Service s'était détaché de la tutelle administrative de l'Ambulance américaine, permettant ainsi le libre développement du Service.
Stephen Galatti, Bulletin of the American Field Service, juin 1939 , p 16
Le Comité américain pour les blessés français s'est récemment associé à l'American Ambulance Field Service, dont les sections de voitures ambulances sont en service actif le long du front de bataille en France. Ce lien facilitera largement la distribution des dons du Comité américain parmi les hôpitaux et soldats blessés de la zone militaire.
American Fund for French Wounded,Monthly Report, Paris, octobre 1916
Anne Morgan était la fille de J.P. Morgan, célèbre banquier, dont la maison représentait aux Etats-Unis, à partir de fin 1915, les intérêts financiers et commerciaux de la France.
Anne Morgan est alors une femme de quarante-quatre ans qui, depuis une dizaine d'années, s'est familiarisée avec la vie associative philanthropique américaine. En outre, sa fortune personnelle, qu'elle n'hésite pas à mettre généreusement à contribution, lui laisse toute latitude pour prendre des initiatives. Le rôle financier joué par la famille Morgan vis-à-vis de la France constitue sa meilleure carte de visite pour dialoguer avec le personnel politique de l'époque.
Evelyne Diebolt et Jean-Pierre Laurant, Anne Morgan, une Américain en Soissonnais(1917-1952), de l'Aisne dévastée à l'action sociale, AMSAM Soissons 1990, p 43
En 1916, parmi les oeuvres américaines se crée la Section civile du Comité américain pour les blessés français (American Fund for French Wounded ) dont une branche est le Comité américain des Régions dévastées (American Committee for Devastated France ), ou C.A.R.D.
Le Comité est organisé dès avant l'entrée en guerre des Etats-Unis pour porter secours aux populations civiles des régions dévastées du nord de la France. Le gouvernement français pense qu'il est important pour le moral des troupes que les régions sinistrées continuent à être habitées et soient reconstruites rapidement, comme on vient de le voir.
Cette section civile s'embarque le 18 mai 1917 à New York à destination de Bordeaux. Elle est composée de Mrs Anne Murray Dike, de Miss Anne Morgan et de Misses Allen, Dolan, Duer, Stevenson, Blagden et Wright. Elle parvient sur le secteur du front compris entre l'Oise et l'Aisne en juin. Le général en chef, Pétain, les installe dans le village de Blérancourt. Dix-neuf Américaines vont y travailler, afin de permettre à ceux qui restent de reconstruire leur vie, leur village. Le quartier général est situé dans les ruines du vieux château des ducs de Gesvres dont le griffon, emblème de la famille, devient celui du Comité.
ibid, p. 49
Le château de Blérancourt avait été bâti dans la première moitié du XVIIe siècle, par l'atelier de Salomon de Brosse, architecte du palais de Luxembourg, aux frais de Louis Potier de Gesvres, secrétaire d'Etat du roi Henri IV et ancêtre des célèbres ducs de Gesvres. A cette époque, c'était un des plus grands châteaux privés érigés en France. Mais l'extinction de la famille de Gesvres au cours du XVIIIe siècle provoqua le déclin de Blérancourt, déclin précipité par la Révolution au cours de laquelle le château fut transformé en carrière pour la région.
Après l'émigration de son dernier possesseur, tous les matériaux du château furent vendus : il ne subsista de la splendeur déchue que deux portes monumentales de la cour d'entrée et de la cour d'honneur, deux petits pavillons de cette cour d'honneur et une partie de l'aile gauche de l'édifice central.
André Girodie, cité dans Bulletin of the American Field Service, juin 1939, p. 17
Il ne restait en fait que des tas de pierres recouverts de végétation
lorsqu'en 1917, l'Armée française reprit Blérancourt aux Allemands et y
installa les baraques du Comité américain des régions dévastées.
Les femmes qui constituent le Comité américain vont vivre la vie
quotidienne du peuple français pendant deux étés et un hiver. Au début,
les Américaines s'occupent de trente villages. Six mois plus tard, ce
nombre a doublé.
N'oublions pas qu'en 1917, cette région de l'Aisne est démunie de tout. En conséquence, l'action du Comité américain comporte l'acheminement de nourriture de première nécessité, d'habits, de couvertures, d'ustensiles de cuisine, d'outils agricoles, de semences et de bétail, l'ouverture de magasins et la distribution de ces biens grâce à un service motorisé. Les personnes civiles n'ont pas le droit de vendre de la nourriture ni d'autres biens dans la zone des combats ; néanmoins, les Américaines obtiennent ce droit. Leur champ d'action s'étend à la région comprise entre Chauny, Coucy-le-Château et Vic-sur-Aisne. En janvier 1918, un grand dépôt est ouvert à Soissons. Il s'agit de fournir à chaque famille un toit provisoire et les objets de première nécessité tels que des lits, des draps, des chaises, des tables, des lampes, des commodes, des torchons et des serviettes. Chaque membre de chaque famille est vêtu de neuf et nourri.
Diebolt et Laurant, op.cit., p 50.
L'oeuvre du CARD continua jusqu'en 1924. La région étant alors largement
reconstruite, le Comité prit sa retraite après avoir créé deux
institutions pour perpétuer son action : l'Association d'hygiène sociale
de l'Aisne (aujourd'hui, l'AMSAM - Association Médico-Sociale Anne
Morgan) et les Amis du Musée.
Après la mort de sa fidèle amie Anne Murray Dike en 1927, Anne Morgan légua le musée à ses amis français. Mais n'ayant pas les moyens pour entretenir un musée, la municipalité de Blérancourt dut s'en dessaisir au profit de l'Etat, ce qui aboutit à la création du musée national de la coopération franco-américaine en 1929. Les Amis du Musée, comptant parmi eux l'ancienne directrice du Comité américain pour les blessés français, Anna Murray Vail, dotèrent le musée d'objets d'art, de gravures, etc., mais aussi de souvenirs, documents d'archive et livres sur des thèmes franco-américains.
Le 11 septembre 1938, un nouveau pavillon était inauguré au musée de Blérancourt. W. De Ford Bigelow prit la parole au nom de l'AFS :
Parlant très brièvement au nom des membres de l'American Field Service, permettez-moi de vous dire combien nous sommes fiers et heureux d'avoir enfin en France, grâce au Gouvernement français que vous représentez ici, et grâce également à Madame Vanderbilt et à Mademoiselle Morgan, un abri pour nos souvenirs de la Grande Guerre, et que cet abri fasse partie du Musée de Blérancourt où se trouvent déjà réunis les souvenirs des Volontaires français de la Guerre d'Indépendance des Etats-Unis.
Dans le Bulletin of the American Field Service, juin 1939, p.12
Le conservateur du musée, André Girodie, fit cette description du nouveau pavillon :
Dans les nouvelles salles du Musée de Blérancourt, la mémoire de ces premiers Volontaires est évoquée par des souvenirs de famille, véritable reliques offertes à la France, sur la demande de la mère de l'un des pilotes américains morts pour notre pays. [...] Dans une autre salle, l'association des ambulanciers de l'American Field Service a placé le monument du Colonel Abram Piatt Andrew, son fondateur, entouré des drapeaux et des fanions que les volontaires de ce service déployèrent sur tous les fronts de la guerre mondiale. Au-dessous de la salle du monument Piatt Andrew, dans la partie basse du Château, une voiture automobile d'Ambulance rappelle aux visiteurs la bravoure et l'esprit de sacrifice de l'American Field Service, des 'Bons Samaritains' de nos lignes de feu où nombre d'entre eux furent tués ou blessés.
ibid, p. 18
Deux objets inspiraient particulièrement les "anciens" : le buste
d'Andrew mort en 1936 après une carrière comme représentant de
l'Etat de Massachusetts à la Législature américaine, et l'ambulance
Hunk o' Tin, relique de leurs chers "bouts de feraille" ambulants.
L'ouverture du pavillon des Volontaires fut un succès sur fond
d'actualité internationale bien sombre.
Au jour où se déroulaient ces cérémonies, l'idée que cette guerre pourrait se répéter préoccupait tout le monde. Des réservistes français avait été rappelés sur la Ligne Maginot, au cas où la crise tchécoslovaque déclencherait un appel aux armes. Les journaux clamaient leur crainte de la guerre et beaucoup des personnalités attendues à Blérancourt avaient été obligées de rester à Paris à cause des tensions internationales.
Lansing Warren, cité dans le Bulletin of the American Field Service, juin 1939

Vingt ans après la fin de la première guerre, l'AFS s'était "assagi", l'Association étant devenue une sorte de club des anciens avec des réunions intermittentes et des parutions ponctuelles du Bulletin ; les French Fellowships étaient toujours gérés par l'Institute of International Education (le rôle de l'AFS étant limité à un droit de veto à propos d'une candidature) ; après la mort de Piatt Andrew, le "bureau" était réduit à la seule personne de Stephen Galatti.
Né le 6 août 1888 à Monmouth dans le New Jersey, Stephen Galatti était le fils d'immigrants grecs, Paul Stephen et Angélique (Kessisoglov) Galatti. Il fit ses études secondaires à la très cotée St. Mark's School et se distingua ensuite à Harvard dans la promotion de 1910, comme quarterback - à la fois cerveau et maître d'oeuvre - de son équipe de football (américain). Il fut ensuite embauché par Ralli Brothers, une société d'import-export traitant avec l'Inde, où il travailla de 1911 à 1914, dans les bureaux de New York, Londres et Calcutta.
Dès le début de la guerre, Galatti quitta Ralli Brothers pour proposer ses services à l'ambassade américaine à Londres, où il resta jusqu'en novembre. En 1915, il se porta volontaire à l'AAFS qui l'envoya dans la section 3, affectée aux Vosges.
Le 12 février 1916, Stephen Galatti de la promotion de 1910 écrivit la lettre qui suit :
"Harvard joue un rôle important dans l'oeuvre de l'American Ambulance Field Service. Jusqu'ici, 73 anciens de Harvard s'y sont associés et il se trouve que la majeure partie de ceux-ci a été affectée à la section qui travaille en Alsace. Cette section y a été envoyée en avril et, après dix mois de service, a été transférée à une autre armée. En Alsace, la section a eu l'occasion, étant donné la topographie de la région, de jouer un rôle pionnier dans l'évacuation des blessés de ces montagnes par automobile, les petites Ford remplaçant les mulets, dès que quelques dizaines de centimètres pouvait être ajoutés à la largeur des sentiers. En juin, pendant une attaque, la section a démontré qu'une évacuation efficace pouvait être effectuée sur une seule route de montagne. Plus tard, en octobre et à nouveau en décembre, la section a pu faire face à des conditions difficiles à Harmanswillerskopf. Entre les attaques, le service quotidien, sur des routes de montagne, couvertes de boue, de neige ou de verglas, s'effectuait régulièrement et a réduit le temps de transport des blessés de trois heures à moins d'une heure, voire même une fois, de cinq à deux heures."
cité dans M.A. DeWolfe, ed. The Harvard Volunteers in Europe, Cambridge MA, 1916, p. 115-116
Peu de temps après, Piatt Andrew le rappela à Paris et lui confia le poste de quarterback du quartier général.
Quand vous entriez au 21 rue Raynouard au printemps 1917, vous étiez étonné par l'agitation qui y régnait : les bagages, le ravitaillement, les jeunes recrues défilaient en une interminable procession. Le personnel du bureau, débordé de travail, faisait peu de cas de votre présence. Si vous arriviez à coincer l'un d'eux pour lui dire ce que vous vouliez, il vous renvoyait avec lassitude vers quelqu'un d'autre. Finalement, si vous persistiez dans votre démarche, quelqu'un vous aiguillait vers une porte marquée "Mr Galatti". Vous entriez - il s'arrangeait toujours pour prendre le temps de voir tout le monde - et remarquiez tout d'abord le bureau le plus désordonné du monde. Personne n'aurait pu faire une description assez fidèle à la réalité de ce bureau. On y trouvait de tout : lettres, papiers, livres, carnets, crayons, cigarettes et encore des lettres, des tas de papiers, des tas de lettres... Vous pouviez à peine distinguer Galatti, assis de l'autre côté. Vous exposiez votre cas et il vous écoutait. Très probablement, pendant que vous parliez, il répondait au téléphone et prenait des notes illisibles, n'ayant aucun rapport avec le sujet ; mais cela n'avait aucune importance. Il vous entendait, vous comprenait parfaitement. Quelquefois il vous disait que vous ne pourriez pas obtenir ce que vous vouliez : c'était alors terminé, tout le monde savait que ce n'était pas un moyen plus ou moins habile de se débarrasser de votre présence. D'autres fois, s'il pensait que vous ne racontiez que des bêtises, il ne répondait pas du tout, mais écoutait et écoutait encore jusqu'à ce que vous soyez lassé et que vous partiez. Jamais il ne vous traitait d'idiot. Il ne traitait jamais personne de la sorte. Sachant qu'il y avait une cinquantaine d'hommes par semaine qui traversaient la rue Raynouard et que chacun d'entre eux avait ses petites réclamations, on se demande comment il pouvait garder son calme. Mais il ne s'énervait jamais - cela aurait pris du temps et il n'avait pas de temps à perdre. Généralement, quand vous étiez à bout d'argument, il disait quelque chose de bref et décisif : "Le meilleur train part à 8 heures de la gare de l'Est", ou "Allez voir au 26, avenue des Ternes" ou "Votre cousin est dans la section 8. Il reviendra en permission d'ici un jour ou deux." ou "je vais m'en occuper". Il s'en occupait toujours. Vous ne le croyiez pas au début. Vous n'aviez pas imaginé qu'il pût s'en souvenir ou qu'il pût trouver le temps de faire quoi que ce fût. Mais il vous détrompait. Aussi incroyable que fût votre demande, s'il vous disait que cela pouvait aller, il avait toujours raison ; un ou deux jours après, il vous rendait votre malle qui avait disparu, ou vous trouvait une place dans la section à laquelle vous teniez tellement.
John R. Fisher, AFS Bulletin, avril 1919
Après la guerre, Galatti retourna aux Etats-Unis où, pendant plusieurs années, outre son travail, il apporta ses compétences au rôle d'entraîneur de l'équipe de football de St. Mark's School. En 1919, il était embauché dans la société financière John Monroe et Cie, où il occupa divers postes dans leurs bureaux de New York et de Paris, jusqu'à la dissolution de la société en 1930. De 1930 à 1954, il fut agent à la Bourse dans la société d'échange Jackson et Curtis (qui devint Paine, Webber, Jackson et Curtis).
En 1925, Galatti se maria avec Grace S. Montgomery avec qui il eut un enfant, Stephen Jr. Sa femme mourut neuf ans après. Il ne se remarierait pas.
En 1939, alors que le monde sombrait encore dans une guerre meurtrière, rien n'allait empêcher cet ancien quarterback de se lancer à corps perdu dans la bataille. Il resterait pourtant à New York et dirigerait ses troupes à partir de Beaver Street. Le quartier général de l'AFS avait troqué la compagnie de la tour Eiffel contre celle des gratte-ciel de Wall Street.

Le 3 septembre 1939, la France et la Grande Bretagne déclaraient la guerre à l'Allemagne. Stephen Galatti ne se fit pas attendre pour réactiver le service ambulancier de l'AFS. Bon nombre d'anciens ambulanciers se présentèrent alors pour "remettre ça", mais Galatti leur confia plutôt la tâche d'organiser et d'animer la matrice de base aux Etats-Unis.
"Je crois qu'il est très difficile pour nous tous," écrivit Galatti, "de comprendre que ceci est un travail de volontaires du même âge que nous lorsque nous sommes partis ; maintenant nous devons nous consacrer à la promotion du Service en essayant d'éveiller l'intérêt de personnes susceptibles de nous soutenir financièrement. Nous devons bien nous rendre compte que notre responsabilité est d'assurer la continuation du Service, à travers des hommes plus jeunes que nous". En dépit de cet avertissement, ce n'était pas toujours facile de calmer les ardeurs de ceux qui se bousculaient pour partir ; il fallait leur prouver que leurs talents seraient beaucoup mieux utilisés à la tête des comités locaux.
Rock, op.cit., p 30
Depuis son quartier général de New York, installé chez Curtin, Miller, Mitchell et Taliaferro (un cabinet d'avocats dont chaque partenaire avait été un ambulancier de l'AFS pendant la première guerre), le réseau s'étendrait rapidement à travers des comités établis par les "anciens" à Boston, Chicago, Cleveland, Cincinatti, en Californie, en Floride, dans le Vermont... De vieux amis, Mme Vanderbilt par exemple, revinrent apporter leur concours financier. D'autres, pour ne pas s'opposer ouvertement à l'isolationnalisme américain, firent de même mais plus discrètement. Des anciens du corps d'ambulanciers Norton-Harjes se joignirent à eux. On allait remettre la vieille machine en état, remplir le réservoir, afficher la cocarde de Tous et tout pour la France et démarrer ! Inutile de dire qu'il fallait un bon conducteur...

Stephen Galatti est à la tête de l'AFS, il dirige l'AFS... l'AFS c'est lui ! C'était sa sincère foi dans le service ambulancier qui avait ressuscité ce dernier... Les accomplissements à l'étranger, les victoires dans les batailles bureaucratiques à Washington et le fonctionnement efficace des bureaux de l'AFS à New York sont tous plus ou moins redevables à la personnalité de Stephen Galatti. C'était un véritable philanthrope, donnant tout et ne recevant en retour que la confirmation qu'un idéal pouvait effectivement servir à des fins pratiques.
[...]
Tel un moteur bien rodé et indispensable, Stephen Galatti se plaçait au centre de tout. "Au cours d'une seule journée" écrivit Joan Belmont, "on l'a vu s'entretenir avec une mystérieuse "grosse légume" du saint des saints des Affaires étrangères, interviewer un éventuel mais timide volontaire, prendre des notes au téléphone, ramener des boissons fraîches de la buvette du coin et, étant le dernier à quitter le bureau le soir, verrouiller les fenêtres et éteindre les lumières. Il refuse un bureau séparé, lui préférant un coin de la vaste salle d'opérations qu'est le QG d'AFS à New York. Autour de lui, les machines à écrire crépitent et les téléphones sonnent sans cesse. En plus, il y a un défilé incessant d'ambulanciers, anciens et nouveaux qui, chargés comme des mulets, font une entrée fracassante, s'interpellant avec des cris dignes des plus féroces fantassins du désert... Mr. Galatti ne vit pas en dépit de ces perturbations mais avec . Il dit qu'il aime savoir ce qu'il se passe..."
George Rock, op.cit., p. 587

En octobre 1939, Lovering Hill, le doyen des chefs de section d'ambulanciers de la première guerre, accepta de prendre la direction des opérations en France à partir d'un local de la National City Bank, 52 avenue des Champs-Elysées. Il fut bientôt secondé par Mme Renée Grimbert et Mlle Germaine Bétourné, les "survivants" du 21 rue Raynouard.
Un des soucis majeurs de M. Hill était d'assurer la qualité des volontaires sélectionnés par les représentants des comités. Début septembre, il avait écrit : "Etant donné le contrôle militaire exercé sur le volontaire - ce qui, vous le savez bien, n'était que symbolique pendant la dernière guerre - il est impératif que la barre soit mise très haut."
George Rock, op.cit., p 30
Les ambulances allaient être élaborées à partir d'une voiture de General Motors surmontée d'une carrosserie construite par des artisans parisiens. Ce ne serait pas simple. Les entraves bureaucratiques ne manquaient pas, tandis que dans les ateliers de carrossiers, les mécaniciens disparaissaient à cause de la mobilisation. La dernière de la vingtaine d'ambulances commandées ne serait livrée que le 14 mai 1940.
Hommes et ambulances juxtaposés ne suffisant pas à constituer un Service, il fallait encore organiser l'entité juridique et faire accepter celle-ci par les autorités françaises. Heureusement, AFS ne manquait pas de relations.
|
Marseille, le 17 février
1940 Dans toute famille, c'est une douce consolation pour un "grand-père" de
voir naître ses petits-enfants; mais son bonheur devient complet
lorsqu'il constate que ces petits-enfants sont doués des magnifiques
qualités de leurs parents. A moi, qui suis très fier de mon titre de "père des Sections américaines
en France", vous venez donc d'apporter ce bonheur complet en me faisant
connaître la nouvelle réorganisation de l'A.F.S. avec l'élan généreux
des "jeunes" de votre grande Nation, pour venir en aide à mon cher Pays,
dans la lutte pour la Liberté mondiale. |
Le processus d'accouchement juridique et d'agrément officiel aboutit le 18 avril 1940. Il avait fallu en outre régler la question d'une éventuelle association avec d'autres corps d'ambulanciers en voie de constitution.
Il était clair qu'il fallait éviter tout "enchevêtrement", que cela soit avec un groupe américain ou français, aussi bien intentionné soit-il. En dépit de cela, une pression était exercée de l'intérieur et de l'extérieur pour pousser l'AFS à fusionner avec un autre organisme qui comprenait des "anciens". Ce fut seulement après l'embarquement de la section n° 1 de l'AFS à New York, le 23 mars 1940, que la pression faiblit, s'évanouissant complètement devant les vivats spontanés des Français à l'arrivée du premier groupe d'Américains venu aider la France.
George Rock, op.cit., p. 31
Le 3 avril, les volontaires débarqués du bateau se joignirent à leurs confrères déjà en Europe et installés depuis deux jours dans les locaux de la maison américaine de la Cité universitaire. L'arrivée des nouvelles recrues fut mémorable. Après une réception officielle organisée par les dignitaires des deux pays, les jeunes Américains furent livrés à une horde de journalistes et prêtés à des mises en scène interminables pour les besoins des caméras. Mais la récolte fut bonne. Le lendemain, l'AFS était à la une de tous les journaux : "L'histoire se répète", "Aucun Français n'a oublié le dévouement de l'admirable équipe de la Grande Guerre."
Les ambulances n'étant pas encore livrées, il fallut attendre ; on en profita pour acheter les uniformes, visiter Neuilly et Paris. Vers la fin du mois d'avril, la section n°1 fut officiellement affectée au 19e train de la dixième armée française. Dans les allées de la Cité universitaire, on s'exerçait à conduire les ambulances, à les charger et les décharger. Le départ était prévu pour le 21 mai, après une inauguration solennelle aux Invalides. C'était sans compter avec les exploits militaires des Allemands. Le 11 mai, on annula la cérémonie aux Invalides. Le soir du 17, on mit la dernière couche de peinture sur les dernières ambulances.
Le lendemain matin, les 20 ambulances, une voiture d'état-major, deux camions de réparation et une immense remorque pour la cuisine étaient parqués devant la maison. La section défila le long des rues désertées entre la Cité universitaire et la Gare d'Orsay, traversa la Seine et remonta les Champs-Elysées jusqu'à la place de l'Etoile pour se garer le long du trottoir circulaire : il était 7 h 30 du matin. Des représentants de l'armée et du gouvernement français, le personnel du QG de l'AFS et les ambulanciers de la section n°1 se mirent au garde-à-vous pendant quelques minutes devant le tombeau du soldat inconnu. Après cette simple cérémonie, les ambulanciers regagnèrent leur voiture, firent un tour de l'Etoile et descendirent l'avenue de Wagram, puis le boulevard Berthier, avant de se diriger vers Beauvais, à 60 kilomètres au nord.
George Rock, op.cit., p 35
A Beauvais, en attendant les ordres, la section relayait le personnel surmené d'un hôpital civil voisin. Déjà, un fleuve de réfugiés traversait la ville, fuyant les Allemands, plus au nord. La nuit du dimanche, le 19 mai, la section prit le contre-courant de ces réfugiés, se dirigeant vers Amiens, déjà en flammes.
Pendant les 20 premiers jours de leur service en France --- Beauvais, Amiens, Agel --- les ambulanciers de l'AFS allaient évacuer plus de dix mille blessés. Du 5 au 8 juin, au coeur de ce que le général Weygand baptisa "la bataille de France", la section fut rejointe par une équipe de cinéastes venus documenter le service. Beauvais était alors la cible de bombardements intenses de la part des Allemands, ce qui n'empêcha pas l'acteur principal du futur film, le célèbre Robert Montgomery, de se montrer à la hauteur de la situation.
Nous l'envoyions faire de sales boulots, mais devant son aplomb et son excellent travail sous les bombardements et les rafales de mitrailleuse, nous avons fini par le considérer comme un de nos meilleurs hommes.
ibid, p. 41
Le 8 juin, la section quitta Beauvais pour Corbeil-Cerf, à 20 kilomètres au sud. Le 9, elle reçut l'ordre de se replier sur Bouffémont, à une vingtaine de kilomètres au nord de Paris, puis ce fut la retraite: Houdan, Pontlevoy (près de la forêt de Choussy). Le 17, deux ambulanciers aventureux se laissèrent prendre par des sturmtruppen (troupes d'attaque). Le lendemain matin, on les fit marcher vers le Nord avec une colonne de prisonniers. Au nord d'Etampes, ils s'arrêtèrent pour se reposer et se ravitailler.
"Conforté par la nourriture, la boisson et les encouragements des réfugiés, je me sentais mieux... La relève remplaçait nos surveillants de la veille. Je les observais soigneusement et compris qu'aucune instruction particulière n'avait été émise à notre égard. C'était maintenant ou jamais. Nous traversâmes donc la route, nous installant sur le rebord d'une fenêtre ouverte, allumant des cigarettes et balançant nos jambes comme si de rien n'était...
Nous regardions partir nos anciens surveillants qui, d'un pas solennel, disparurent au tournant de la route menant au camp de prisonniers où nous avions passé une nuit si inconfortable. Le sergent de la relève donna l'ordre de se remettre en route. Il dirigea son regard vers nous, toujours assis sur le rebord de la fenêtre, et nous interpella "Eh ! Vous autres, à vos rangs ! Pour qui vous prenez-vous?" J'exhalai lentement la fumée de ma cigarette, envoyant négligemment le mégot de l'autre côté de la chaussée et, m'éclaircissant la voix, je répondis, "Si vous vouliez avoir l'amabilité de vous montrer plus respectueux envers un officier et de venir ici, je serais ravi de vous dire qui nous sommes." Le ton de ma voix le surprit. Moi aussi. J'avais eu une arrogance digne d'un capitaine prussien. Il vint vers nous, ne sachant pas s'il devait s'emporter ou garder sa place en tant que mon inférieur hiérarchique. Je répondis négligemment à son salut. "Nous sommes..." commençais-je, sentant De Belle se raidir à mes côtés. Ce dernier ne comprenait pas l'allemand, mais ayant été formé dans le théâtre, savait instinctivement que nous atteignions le dénouement. "Nous ne faisons pas partie de vos charges et n'avons jamais été prisonniers. Il se trouve que nous sommes en train d'attendre une voiture..."
ibid, p. 45
Muir réussit si bien à faire passer et lui et son compagnon pour des médecins américains en mission que l'Allemand leur héla une voiture pour les ramener à Paris. Entre temps, l'AFS filait toujours vers le Sud, transportant maintenant plus de personnel médical français en panne d'équipement que de blessés. Tout se termina le 22 juin avec l'armistice. Neuf jours après, l'AFS dans sa totalité --- quartier général et section --- traversait la frontière au pont international d'Hendaye. Les ambulances, par contre, restèrent en France et furent ramenées à l'Hôpital américain de Neuilly.
L'objectif déclaré de l'AFS avait maintenant cessé d'exister. Le sort du matériel de l'association fut déterminé par M. Barber avec l'approbation de M. Galatti. Tout était mis à la disposition de la Croix-Rouge américaine. [...] Vers la fin de l'automne, lorsque le travail de la Croix-Rouge américaine fut terminé, les ambulances furent données au Secours National pour le transport de réfugiés et de provisions.
ibid, p. 51
 |
 |
 |
 |
La conclusion de ce chapitre de l'histoire de la coopération franco-américaine fit comprendre à l'AFS que sa mission, née en France, avait une portée plus universelle. "Tous et tout pour..." mais pour quoi ? Pour qui ? Et où ?
Aux Etats-Unis, la machine tournait à plein. La matrice de base fonctionnait merveilleusement. Le bureau de New York encaissait des contributions sans les solliciter, faisait le tri de candidats sans avoir à les recruter. Restait donc la redéfinition de la matrice opérationnelle de l'AFS, qui mettrait en oeuvre l'expression de toutes ces bonnes volontés.
De juin 1940 à novembre 1941, l'AFS allait envoyer ambulances, hommes et contributions financières pour soutenir différentes activités.
Angleterre. En juillet 1940, les premières ambulances de l'AFS arrivèrent à l'Ambulance américaine de Grande-Bretagne. Au cours de la guerre, 149 ambulances serviraient à l'évacuation des victimes de bombardements et au transport de blessés, d'invalides, de malades ou d'enfants vers des régions moins dangereuses. Les conducteurs étaient des femmes anglaises, dont le courage n'avait rien à envier à celui de leurs prédécesseurs masculins.
La nuit du dimanche 24 novembre, la ville de Bristol fut le théâtre d'un véritable enfer... Après l'explosion, Bridget, qui était dans le couloir, se jeta sous l'escalier ; Patricia, qui était dans la buanderie, fut ensevelie sous une avalanche de vaisselle ; Barbara, dans le salon, fut recouverte des cendres issues de ce qui avait été une cheminée. Joan était dans la salle à manger et cette pièce resta intacte.[...] Dorothy et Helen étaient en permission à Bath où elles dînaient quand elles entendirent le blitz [attaque "éclair" aérienne]. Elles louèrent les services d'un taxi qui les déposa aux portes de Bristol. [...] Elles parcoururent à pied les trois kilomètres qui les séparaient de la maison, longeant des rues aux immeubles en feu et aux bâtiments qui s'écroulaient. La maison était en ruines. Elles se dirigèrent alors vers le garage du dépôt, sortirent leurs ambulances et passèrent le reste de la nuit à conduire... Maintenant, à Bristol, on commence à s'habituer aux blitz.
George Rock, op.cit., pp 53-54Kenya. Fin 1940, anticipant les conséquence d'une campagne anglaise contre les Italiens en Afrique orientale, l'AFS envoya des mécaniciens, des ambulances, un appareil radiographique portatif, des provisions médicales et des pièces de rechange aux forces anglaises du Kenya. La campagne fut de courte durée et on donna le matériel aux autorités britanniques qui l'utiliseraient pour leurs services médicaux en Afrique orientale. AFS laissa derrière lui une cantine qu'il avait financée pour les besoins des troupes anglaises.
Londres. En décembre 1940, s'ouvrit le Eagle Club, lieu de rencontre et de repos pour les volontaires américains vivant alors dans la capitale anglaise. AFS avait versé une somme importante pour le soutien de cette oeuvre, qui comprenait des salles de lecture et de détente, un bureau de renseignements, des douches, une cantine et un service de magazines et de revues américaines.
Grèce. Les origines familiales de M. Galatti l'amenèrent à oeuvrer pour l'Association d'assistance aux victimes de guerre grecques, dont il était un des directeurs. 50 ambulances furent envoyées en Grèce à partir de Bombay, dont 25 arrivèrent avant la capitulation face aux Allemands en avril 1941. Une grande proportion de l'armée grecque réussit à se replier au Moyen Orient où elle se rattacha aux forces anglaises. Plus tard, les sections de l'AFS associées à la 9e armée anglaise prêteraient une attention particulière aux troupes et réfugiés grecs.
Palestine. Une première tentative pour s'associer aux Forces Françaises Libres (FFL) aboutit à une participation aux activités de l'hôpital Hadfield-Spears au Moyen Orient.
Ce fut une affectation expérimentale pour l'AFS - à peine dans la lignée de ses traditions - mais un premier pas vers les activités dont il avait l'habitude. Les volontaires de l'AFS faisaient partie d'un groupe anglais attaché à une unité française sous les ordres de l'armée britannique. Au début, on ne savait pas si le champ d'action serait l'Afrique équatoriale ou l'Afrique du Nord. Le médecin responsable du contrôle médical préconisa un vaccin contre le typhus, au cas où les hommes seraient envoyés dans une région où "les habitants portaient des habits."
ibid, p. 58
Les ambulanciers américains --- "jeunes millionnaires sauvages de New York" --- essaieraient de collaborer avec une unité de Quakers anglais - "doux objecteurs de conscience britanniques" - dans le cadre d'un hôpital géré par une romancière américaine mariée à un général anglais et où la lutte pour le pouvoir tournerait au profit du personnel médical français. Durant la campagne des Alliés en Palestine, les hommes de l'AFS firent office d'ambulanciers et de brancardiers de cet hôpital. Mais en mai 1941, remplacés par une nouvelle vague de Quakers, ils se joignirent, par petits groupes, au Groupe Sanitaire Divisionnaire des FFL à Damas.
Ce fut alors que Muir offrit une section d'ambulances de l'AFS aux Anglais, qui manquaient également de transport et d'hommes. Cette décision marqua le début de la bataille entre anglophiles et francophiles. Pendant les années qui suivirent, cette bataille allait être menée de mille manières, pas toujours à la gloire de l'AFS ; pourtant, aucune n'occulterait jamais la mission que M. Galatti s'était assignée. Il avait toujours été clair que l'American Field Service avait été créé pour aider les Français et qu'il souhaitait toujours oeuvrer pour la France ; c'était effectivement le cas, mais à une échelle trop réduite au goût des deux parties. Alors que la situation politique était telle que les Français ne pouvaient pas formuler des demandes précises, le Field Service eut la chance de pouvoir travailler pour les Anglais.
George Rock, op.cit., p. 62
Les négociations de Peter Muir aboutirent à un accord entre l'AFS et les autorités anglaises. Entre temps, aux Etats-Unis, la matrice de base n'avait cessé de prendre de l'essor. Des représentants de plus en plus nombreux dans les comités et quelques dons très généreux permirent à l'AFS de réaliser ses ambitions dans le cadre d'un service avec l'armée britannique au Moyen Orient. Désormais, "tous" allaient donc "tout" faire pour... les Anglais !
 |
 |
 |
Les volontaires avaient beau s'inspirer d'Ulysse ou de Christophe Colomb, le voyage allait être une épreuve de ... monotonie. 110 jours d'interminables tangages dans la houle allaient séparer le départ de New York, le 10 novembre 1941, de l'arrivée à Bombay, en janvier 1942. La présence de sous-marins dans l'Atlantique interdisait tout déplacement en ligne droite et le trajet entre les Etats-Unis et l'Orient passait par le Cap de Bonne-Espérance. Certains des passagers, pour passer le temps, se portèrent volontaires pour remplir des tâches à bord. L'annonce de l'entrée en guerre des Etats-Unis, le 7 décembre 1941, précédant de quelques jours l'escale à Capetown, ne fut pas sans effet sur un petit nombre de désoeuvrés qui allaient quitter l'AFS pour s'engager dans des unités militaires américaines. De toutes façons, l'unité de l'AFS quitta Capetown et poursuivit son chemin, changeant de bateau à Bombay et finissant par arriver à Toufiq, dans le golfe de Suez, le 10 février 1942. Les futurs ambulanciers subirent alors une semaine d'orientation si intense que certains jureraient par la suite qu'elle avait duré le double de temps. Il fallait se préparer au désert. Le lieutenant Waller les accueillit avec ces mots :
Il n'y a rien de sorcier dans la confrontation des obstacles insurmontables du désert. Il s'agit surtout d'adaptation. Vous devez savoir vivre avec le désert. N'y résistez pas. Si vous vous y opposez, il finira par vous avoir... La navigation dans le désert est d'une grande importance pour chaque unité, mais encore plus pour chacun de vous... Se perdre serait non seulement fâcheux pour vous mais en plus, vous vous mettriez en état d'infraction avec la loi.
ibid, p. 68
Une semaine plus tard, les premières sections de l'AFS à se joindre aux Anglais, se dirigèrent vers Beyrouth où elles allaient servir aux côtés d'unités néo-zélandaises dans le cadre de la 9e armée.
Cependant, le front, où le maréchal Rommel préparait son attaque contre la 8e armée anglaise, se trouvait plus à l'ouest, le long d'une ligne commençant à Gazala sur la côte à l'ouest de Tobrouk et allant vers le Sud jusqu'à Bir Hakeim. Tandis que de nouvelles recrues de l'AFS se dirigeaient vers le théâtre des opérations, d'autres servaient déjà aux côtés de la Légion étrangère à Bir Hakeim.
La résistance des Français pendant la bataille de Bir Hakeim, fin mai - début juin, contraria considérablement les plans de Rommel. Les ambulanciers de l'AFS qui y participèrent perdirent la totalité de leur matériel ; leurs hommes furent tués, blessés ou faits prisonniers.
Le général Charles de Gaulle écrivit :
"témoignant de l'actif dévouement avec lequel l'American Field Service s'est dépensé pour la France Combattante... La France n'oubliera pas ses amis d'Amérique qui ont fait volontairement pour elle le sacrifice de leur vie."
George Rock, op.cit. p. 84
L'AFS était également attaché à la division néo-zélandaise dans le cadre de la 8e armée, affectation préférée des ambulanciers qui trouvaient les "Kiwis" "très charmants" et "presque comme des Américains". Fin juin puis début septembre, les Néo-Zélandais opposèrent une résistance féroce aux Allemands, mattant le projet de Rommel d'en finir rapidement avec les Anglais.
Par contre, l'arrivée du général Montgomery à la tête de la 8e armée, allait marquer le début d'une gigantesque "chasse au renard", dont la première étape fut la bataille d'El Alamein. Du Nord au Sud, les unités "anglaises" attendaient, composées d'Australiens, d'Ecossais, de Néo-Zélandais, d'Africains du Sud, d'Indiens, de Grecs, de Français... Au moment du déclenchement de l'attaque, le 23 octobre 1942, les troupes alliées reçurent ce message du général Montgomery :
Quand j'ai pris le commandement de la 8e armée, j'ai déclaré que notre mandat serait de détruire Rommel et son armée et que cela serait accompli dès que nous serions prêts.
Nous le sommes maintenant.
La bataille qui est sur le point de commencer sera une des plus décisives de l'histoire. Le monde entier aura les yeux fixés sur nous, se demandant avec angoisse quelle sera l'issue de la bataille.
Nous pouvons déjà leur répondre : "Cette bataille, nous la gagnerons !"
George Rock, op.cit., p. 132
Ce ne furent pas de vains mots. Le 3 novembre, la bataille d'El Alamein était finie ; les Allemands fuyaient vers l'Ouest. Les alliés prirent Tripoli le 23 janvier 1943 et Tunis, le 7 mai. Tout était terminé le 13 mai 1943. Les sections de l'AFS, au service de Néo-Zélandais, de Sud-Africains, de Français et d'Indiens, n'avaient pas chômé
"La guerre en Afrique du Nord est finie," écrivit le major Howe, "et nous nous réjouissons du plaisir de pouvoir tous respirer un peu, en profitant du temps qui passe. Nous pouvons réparer le véhicules. Certains peuvent partir en permission. [...] En même temps, personne parmi nous ne peut oublier les hommes tués pendant les derniers jours de la campagne, les blessés. [...] Tout le monde se souvient aussi de ces milliers de prisonniers dans des cages, de la jeunesse de ces hommes, de leur santé, de leurs regards francs".
Arthur Howe, cité par George Rock, op.cit.; p. 199
 |
 |
 |
L'invasion de la Sicile débuta fin juillet 1943. Le 8 septembre, l'armistice avec l'Italie était signé. La 8e armée débarqua dans la région de Naples, le 1er octobre, emmenant ses sections d'ambulanciers de l'AFS. Le terrain montagneux d'Italie donnait l'avantage aux défenseurs allemands. Les campagnes militaires allaient donc s'avérer difficiles : batailles le long de rivières, conflits de front statique (la ligne Gustav, la ligne Gothique) que les Alliés auraient du mal à dominer. Par conséquent, les ambulanciers avaient beaucoup de travail et ce avec des soldats d'origines très diverses : Néo-Zélandais, Polonais, Indiens, Italiens, Anglais, Canadiens, Français. L'AFS fut à la hauteur, comme en témoigne le commentaire d'un commandant anglais.
La bataille de Garigliano ne ressemblait en rien à celle d'El Alamein. A la place de la poussière et de la chaleur, il y avait la pluie et le froid. Au lieu de longues évacuations à travers des pistes désertiques, il y avait de courts trajets difficiles par des chemins traîtres et extrêmement boueux... Je me réjouissais de ma nouvelle collaboration avec le Field Service mais fus momentanément déçu quand je ne reconnus aucun des visages des ambulanciers du groupe... Ma déception fut pourtant de courte durée. Ces hommes avaient beau être des "nouveaux", ils avaient toujours l' "esprit" de l'ancien Service que j'avais connu, et s'acquittaient de leurs tâches avec la même perfection et le même "éclat".
George Rock, op.cit. pp 276-7
 |
 |
 |
On ne peut parler d'une guerre sans faire référence à sa caractéristique principale : l'attente. Ceux qui sont "sous les ordres" sont obligés de remplir le vide, soit en accomplissant des tâches infernales, soit avec des passe-temps aussi banals qu'interminables. Les hommes de l'AFS, par contre, n'étant qu'approximativement sous contrôle militaire, en profitaient au maximum, si l'on peut se fier aux descriptions humoristiques de George Rock. Disons que les hommes de l'AFS, plus que consciencieux sur les champs de bataille, ne négligeaient que très rarement les opportunités de "voir le monde". Mais aussi habitués qu'ils aient été à l'exotisme du Moyen Orient, les sections d'ambulanciers arrivées en Inde pour le service avec l'armée britannique, n'en croyaient pas leurs yeux.
Aucun film, aucun livre ne pourrait vous dresser un portrait véridique de ce pays. Il faut le voir soi-même, le renifler, l'entendre. Je croyais avoir une idée de ce qui m'attendais, mais quand nous avons débarqué pour ensuite traverser le quartier hindou dans un petit ghari (fiacre), je restais bouche bée, mes yeux sortant de leurs orbites.
Chameaux, vaches, mendiants, femmes voilées, gosses à poil, chiens, chèvres, marchands, gens dormant dans la rue et sur les trottoirs (les maisons étant ouvertes au passage des vaches sacrées, les habitants vivent sur les trottoirs et marchent sur la chaussée). Pouvez-vous imaginer que tout cela a lieu dans un passage de la largeur d'une automobile? Il y a en plus l'arôme de plats bizarres, de l'encens, de la crasse - les gens sont sales, et plus sales encore sont les chameaux, les vaches, les chèvres, les chiens - sur fond d'incessante musique aiguë, étrange ; tout cela sans parler des couleurs et de l''architecture.
Les gens portent des habits incroyables : des pantalons bouffants d'un blanc approximatif, partiellement recouverts d'une espèce de chemise de nuit portée sous une veste à rayures bleues et blanches, un fez à la tête. La chemise est généralement de couleur rose, lavande, verte ou violette. Ils sont pieds nus, même les policiers sikhs. On voit toutes sortes de couvre-chefs.[...] On remarque également que les Indiens ne peuvent pas se parler sans crier, aussi prêts les uns des autres soient-ils.
On ne pourrait jamais tout décrire.
George Rock, op.cit., p. 469
L'Inde était d'abord un centre de préparation des ambulanciers pour leurs futures activités sur le front birman où les Japonais les attendaient. Quoiqu'au service de l'armée anglaise, les jeunes volontaires de l'AFS sympathisaient souvent plus facilement avec les jeunes Indiens qu'ils rencontraient qu'avec les autorités britanniques.
En majeure partie, l'intérêt que manifestaient les ambulanciers pour l'Inde se limita au niveau touristique, récompensé par des expériences visuelles des plus extraordinaires. Certains allèrent pourtant plus loin. Les aspects politiques et religieux du pays étaient particulièrement intéressants. Le nationalisme indien fascinait les Américains, d'autant plus que les Anglais interdisaient tout contact entre soldats et autochtones. En même temps, l'hindouisme, avec ses diverses manifestations, exerçait son influence sur tout un éventail de personnalités, des amateurs de théâtre aux mystiques purs et durs, le Field Service, en Inde comme ailleurs, étant composé d'une grande diversité de caractères.Les plus curieux suivirent des cours d'Urdu, langue que tout officier britannique était censé connaître et, par la suite, se lièrent des amitiés parmi les étudiants locaux. Toutefois, ce fut un chemin périlleux. Après quelques mois, le lieutenant Patrick signalait : "il y a un petit groupe de gens sérieux qui croient sincèrement oeuvrer pour le bien de l'Inde et des Indiens. Ce groupe se ferme résolument à toute infiltration du point de vue britannique, de peur d'être influencé dans ce qu'il pense de l'Inde et du joug anglais. Dernièrement, la complexité de ce pays les a obligés à réfléchir davantage. Tous sont choqués par la saleté, la pauvreté et la maladie ; bon nombre en sont même révoltés. Ils sont frustrés de ne pas pouvoir en parler dans leur courrier. L'un d'eux a demandé à sa famille de se renseigner auprès des autorités américaines sur la possibilité de ramener un portier indien aux Etats-Unis."
Personne n'a ramené de portier. Mais certains des volontaires ne rentrèrent pas au pays à la fin de la guerre, et d'autres, ayant vécu une telle expérience en Inde, se virent obligés de changer leur vie de manière plus ou moins radicale.
George Rock, op.cit., pp 469-470
Les sections de l'AFS allaient peiner en Inde. Ce ne serait ni le
désert, ni les pentes boueuses d'Italie, mais la jungle et la guérilla
japonaise, les maladies tropicales et la mousson. Au cours des campagnes
en Birmanie du Nord, l'AFS découvrit que le meilleur moyen d'évacuer
les blessés était la version contemporaine de sa petite Ford
légère de 14-18 : la Jeep. Les sections de Jeep firent revivre encore
une fois la tradition héroïque des "amis des poilus".
Sans prêter attention aux obus qui tombaient autour de lui, Gilliam apporta des soins, non seulement aux blessés à découvert, mais aussi aux blessés des tranchées et des bunkers. Ce faisant, il devait se déplacer dans des tranchées qui n'offraient que la protection d'une profondeur maximum de cinquante centimètres. "Son courage et sa bonne humeur furent un exemple pour tous, contribuant énormément au succès de la défense de la position." S'étant occupé de tous les blessés, Gilliam retourna à l'arrière "pendant des bombardements intenses," selon Jemadar Debi Singh (un témoin officiel) "où il se mit à soigner nos blessés, les ramenant au QG, souvent à partir de positions complètement à découvert, les bunkers ayant été atteints. Pendant tout ce temps, des obus tombaient, souvent tout près de lui"
[...]
Un officier du corps médical avait déclaré qu'un blessé toujours en vie trente minutes après avoir été atteint et qui pouvait être opéré dans les deux heures, était presque sûr de survivre. Autrement dit, beaucoup de vies humaines pourraient être sauvées si les blessés étaient évacués pendant l'action ou immédiatement après et recevaient très rapidement des soins médicaux. Ce principe anima la démarche de Gilliam... Le bien qui avait été accompli fut énorme. Gilliam seul transporta plus de 250 blessés et avait sans doute personnellement sauvé des vingtaines de vies. Il récupéra nombre de blessés lui-même, sur des brancards ou en les portant sur le dos. Les autres ambulanciers en transportèrent proportionnellement autant, en fonction de leur nombre de jours de service. Les officiers gurkhas ne surent comment exprimer leur gratitude et déclarèrent que le moral de leurs hommes avait fortement remonté, depuis qu'ils avaient l'assurance que les blessés reçurent des soins rapides et efficaces. Vers la fin mai, les Gurkhas décidèrent de remettre à Gilliam une épée d'officier japonais, prise au cours d'une récente action. [...] A la fin du mois, la Jeep de Gilliam valait le coup d'oeil. "Une demi-douzaine d'impacts de balles" nota le capitaine Marsh, " y compris celui laissé par la balle qui toucha la colonne de direction au moment où il quittait son véhicule."
George Rock, op.cit., p. 513-514
 |
 |
L'année 1945 vit la fin des combats militaires. En Asie, les Japonais se retirèrent de la Birmanie et tout se termina avant même que l'AFS ait pu réaliser deux de ses rêves: des unités en Chine et un service d'évacuation aérienne. En Europe, après moultes tractations, des sections avaient enfin pu rejoindre les forces françaises qui remontaient le Rhône et la Saône pour reprendre Belfort, l'Alsace, avant de poursuivre leur chemin au-delà du Rhin. Parallèlement, d'autres sections accompagnaient les Anglais qui, eux, entraient en Allemagne, plus au nord.
La guerre, l'AFS l'avait connue. Mais il restait un volet de cette
expérience que personne n'avait prévu. Les Ecossais avaient libéré
le camp de Bergen-Belsen, le 17 avril 1945. Onze jours après, quatre
ambulanciers de l'AFS y arrivèrent afin d'y prêter main forte.
Voici l'extrait d'une lettre que l'un d'eux, L.M. Allen, écrivit :
"Lorsque nous sommes arrivés, nous avons trouvé environ 65.000 personnes de toutes nationalités - Polonais, Russes, Tchèques, Français, Grecs, Belges, etc - et toutes étaient pratiquement mortes, des suites d'une sous-alimentation systématique. C'étaient de véritables squelettes vivants ; ils souffraient de la tuberculose et du typhus, sans compter toutes les autres maladies et complications. Et puis il y avait les cadavres. Il y en avaient des dizaines de milliers. Aucun n'était enterré. Les occupants de ce camp ne recevaient aucun soin. Lorsque quelqu'un mourait, les autres, s'ils en avaient la force, balançaient le cadavre par la fenêtre. Dans bon nombre de bâtiments pourtant, ils étaient trop faibles pour y arriver et les cadavres pourrissaient dans des salles combles. Ces salles étaient si remplies qu'il n'y avait pas de place pour s'étendre, à moins de s'allonger les uns sur les autres. Beaucoup de cadavres avaient ainsi adhéré aux corps des vivants, et on dut les séparer de force. Je sais que tout cela doit te paraître absolument incroyable mais je n'essaie pourtant pas de t'impressionner... "
George Rock, op.cit., pp 421 et sig.

La guerre terminée en Europe, l'AFS rentra au pays. Le retour se fit sans tambours ni trompettes, sans cris de sirènes ni confettis . Ces héros revinrent chez eux de la manière la plus simple et discrète, que ce soit à Brooklyn, à Norfolk ou à Baltimore.
"La première semaine de juillet, il faisait chaud et humide à Baltimore," nota W.A. Whitehead. "Un vieux camion brinquebalant apparut sur le quai pour nous ramener à travers la ville jusqu'à la gare. Nous jetâmes nos affaires sur un tas à l'arrière, au somment duquel nous grimpâmes ; nous transpirions et étions vêtus de loques. Quelques uns portaient des bottes allemandes et un observateur de passage aurait eu du mal à déterminer notre nationalité. Dans le centre-ville, le camion s'arrêta quelques instants à un feu ; je remarquai alors une dame bien habillée et un petit garçon qui nous dévisageaient avec curiosité. Lorsque le camion démarra, j'entendis le petit garçon dire à sa mère sur un ton du plus profond dégoût : "Les sales Boches !" Et c'est ainsi que l'on nous accueillit chez nous !
Rock, p. 463